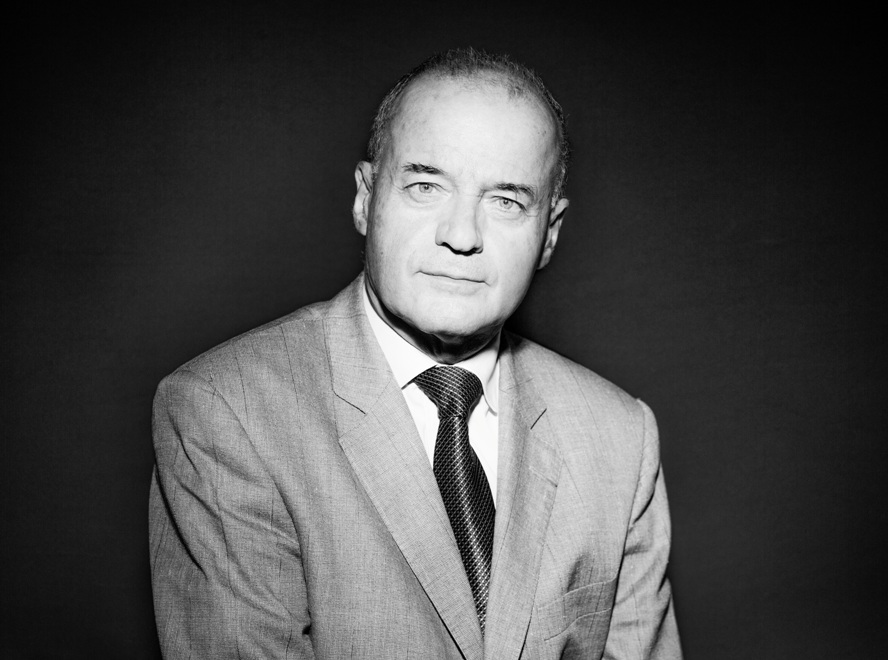Sécurité : l'après New York
RésuméNovembre 1989 : nous ne sommes plus menacés chez nous, et le monde marche vers l’unité. Septembre 2001 : globalisé, ce monde est divisé, instable, et les vulnérabilités des pays développés apparaissent béantes.Le choc du 11 septembre ouvre des perspectives incertaines, inquiétantes. Des conflits que nous croyions cantonnés aux marges du monde peuvent ravager le cœur des métropoles du monde riche. La diffusion des techniques et l’éclatement des acteurs traditionnels du jeu politique rendent inmaîtrisable le paysage international. Au loin, des régions déterminantes pour les équilibres stratégiques de la planète peuvent se retrouver très vite déstabilisées.Le défi est lourd :il nous invite à redéfinir ce que nous entendons par sécurité. Les sociétés technologiques sophistiquées peuvent-elles se défendre, et contre quoi ? Sont-elles condamnées à une vulnérabilité croissante, en raison même de leur modernité ? Doivent-elles répondre aux menaces à l’intérieur ou à l’extérieur ? Les gigantesques appareils militaires détenus par les puissances – et la première d’entre elles, les Etats-Unis – correspondent-ils à la situation ? En définitive le système international peut-il être autre chose qu’une juxtaposition –catastrophique- de forteresses impuissantes ?

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesCartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.
Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.