Le retour de la haute intensité en Ukraine : quels enseignements pour les forces terrestres ?
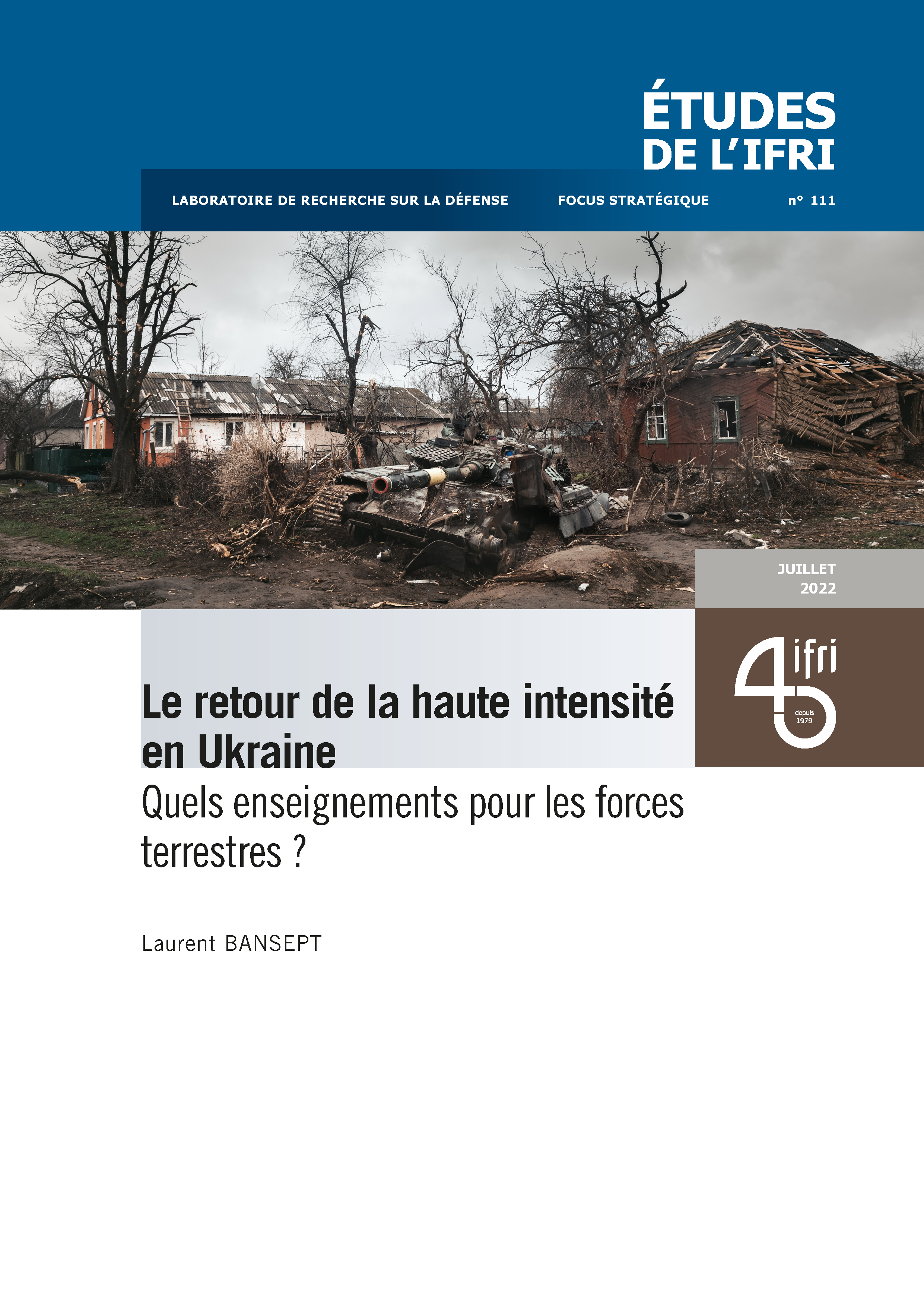
Après vingt ans de contre-terrorisme, le champ de bataille ukrainien marque le renouveau de la guerre dite de « haute intensité ». Il constitue un tournant stratégique majeur, renversant le modèle contemporain des guerres impliquant l’Occident.

Cette invasion massive d’un pays par une puissante armée conventionnelle se joue en grande partie au sol. Elle éclaire la réflexion sur la préparation des forces terrestres à une hypothèse d’engagement majeur. Pour les Ukrainiens, la guerre correspond à un conflit de haute intensité à la fois politique, car il met en jeu leurs intérêts vitaux et capacitaires, mobilisant l’ensemble de leurs moyens militaires. Pour la Russie, la haute intensité est en revanche davantage capacitaire que politique.
Ce conflit se déroule selon le mode d’une guerre linéaire marquée par un « retour » du front, phénomène devenu relativement rare, quoique déjà résurgent en Syrie et en Irak. Comme sur ces théâtres, la guerre d’Ukraine confirme que les villes demeurent les espaces prioritaires, justifiant les efforts portés par l’armée de Terre à l’entraînement sur ce milieu. La guerre urbaine requiert des capacités matérielles élevées en termes de feux, d’effectifs et de logistique mais aussi de forces morales. Le conflit ukrainien rappelle à cet égard la place occupée par la population, mobilisée en soutien de l’appareil de défense. Le taux d’attrition élevé pose la question des pertes humaines et du « seuil de tolérance » si la France venait à être engagée sur des champs de bataille avec une létalité similaire.
Les caractéristiques de la haute intensité ont un impact sur toutes les fonctions opérationnelles.
- Le premier enjeu relève du renseignement militaire. La diffusion et l’exploitation d’informations OSINT (Open Source Intelligence), l’utilisation de caméra de vidéosurveillance et de mini-drones civils sont autant d’innovations ayant pu être exploitées dans le domaine militaire.
- La maîtrise de la manoeuvre interarmes est décisive dans le cadre de cet engagement, avec en son centre le segment lourd, devenu le symbole de la haute intensité. Face au retour d’un adversaire significatif sur le plan aérien et à l’étendue du spectre des menaces évoluant en basse couche (drones, hélicoptères, missiles, munitions rodeuses, feux indirects), la réduction des capacités de défense sol-air de l’armée de Terre représente une vulnérabilité.
- Pour réussir la manoeuvre, un C2 efficace et agile est essentiel. L’expérience ukrainienne montre que la résilience du C2 d’une composante aéroterrestre dépend d’une organisation pensée pour déléguer au maximum l’exécution aux niveaux opératif et tactique. Dès lors, l’intégration des effets des autres milieux et champs doit pouvoir être envisagé jusqu’aux plus bas échelons.
- Enfin, l’exemple ukrainien rappelle opportunément la place des champs immatériels en haute intensité. L’accès pérenne à un internet mobile au plus près du champ de bataille et dans toute la profondeur s’est à ce titre révélé un atout essentiel en matière de guerre informationnelle.
Le conflit ukrainien et ses répercussions sur la stabilité stratégique en Europe mettent en lumière la part des forces terrestres pour « gagner la guerre avant la guerre ». Elle implique un réinvestissement des fonctions « dissuasion » mais aussi « prévention » au travers de signalements stratégiques comme la participation à la réassurance du flanc est de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Chaque exercice militaire doit être pensé comme l’affichage d’une volonté. Pour davantage de crédibilité, il convient de maintenir un haut niveau d’aguerrissement des forces. Disposant d’une expérience opérationnelle unique parmi les armées européennes en la matière, la France doit investir pleinement dans les structures militaires de l’OTAN et de l’Union européenne (UE).
Ce signalement s’incarne aussi dans les actions de préparation des forces étrangères au travers des Partenariats militaires opérationnels (PMO). Dans certains contextes politiquement sensibles les forces spéciales peuvent jouer un rôle unique pour mettre en oeuvre de façon discrète ce type de partenariats.
Il est indispensable de garantir une liberté d’action par une masse suffisante. Les livraisons d’armes à l’Ukraine posent dans cette perspective trois questions : l’impact de l’envoi de matériels en service comme les Caesar sur l’ordre de bataille français ; les possibles transferts de technologie liés à la livraison d’équipements modernes ; le contrôle et le suivi ex-post de ces livraisons d’armes.
Enfin, la triple surprise de l’offensive russe, de la résistance ukrainienne et de l’ampleur de la réaction internationale témoigne de la nécessité de s’approprier la rationalité de l’adversaire et de la difficulté à anticiper ses réactions. Agir en stratège face aux compétiteurs systémiques passe par des efforts soutenus dans le domaine de la « connaissance et anticipation. »

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le retour de la haute intensité en Ukraine : quels enseignements pour les forces terrestres ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.
L’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?
L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.
Char de combat : obsolescence ou renaissance ?
Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.
Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine
La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.












