Les investissements japonais dans la région du Mékong et le facteur chinois
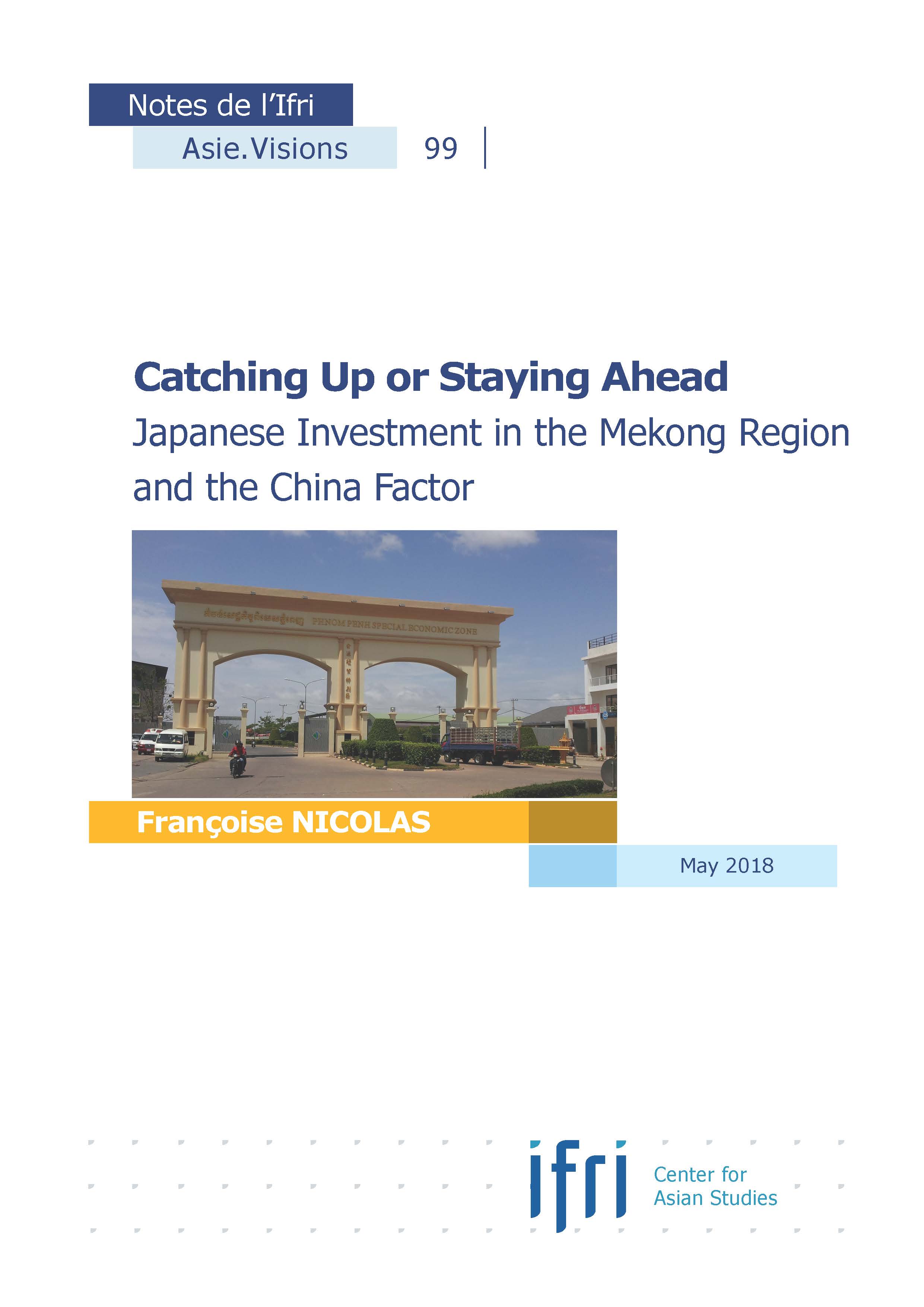
La région du Mékong est devenue un champ de bataille où Japon et Chine s’affrontent pour accroître ou maintenir leur influence économique.

Toutefois, chacun d’entre eux est parvenu à créer ou préserver sa propre sphère d’influence, réduisant ainsi le risque d’une confrontation directe. De même dans chacun des pays concernés (Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam, généralement désignés comme les CLMV), le Japon et la Chine ont tendance à intervenir dans des domaines d’activité ou dans des secteurs distincts, et au moyen d’instruments différents. Les investissements japonais dans les CLMV présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des investissements chinois.
Une première caractéristique des investissements japonais dans les CLMV est leur concentration dans des Zones économiques spéciales (ZES). Deuxièmement, au-delà d’une main-d’œuvre bon marché, certaines entreprises japonaises cherchent à exploiter la proximité avec la Thaïlande et suivent, au Laos et au Cambodge par exemple, une stratégie dite « Thaïlande + 1 », ce qui consiste à transférer les activités les plus intensives en main-d’œuvre dans les pays où celle-ci est moins chère qu’en Thaïlande. En tant que base historique de la production des entreprises japonaises dans la région, la Thaïlande se trouve désormais au cœur de réseaux de production régionaux obéissant à une logique d’intégration verticale. Troisièmement, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam ne sont pas exclusivement perçus par les investisseurs japonais comme des réservoirs de main-d’œuvre bon marché mais également comme des marchés potentiels du fait de la hausse de leur PIB par tête.
Le développement des infrastructures est sans doute le secteur dans lequel la concurrence entre le Japon et la Chine est la plus directe dans la région du Mékong. Dans ce domaine les entreprises et les agences publiques japonaises ont longtemps fait la course en tête.
Il ne fait aucun doute que l’expansion des réseaux régionaux de production s’appuyant sur une division régionale du travail n’aurait pas été possible en l’absence d’infrastructures soutenues financièrement par l’aide au développement japonaise.
Cherchant à améliorer la connectivité entre ses provinces du Sud et la région du Mékong, la Chine s’est récemment lancée dans un vaste effort d’investissement dans les infrastructures, qui a pris une tout autre ampleur au cours des dernières années dans le cadre de l’Initiative des nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative – BRI). De ce fait la région du Mékong est devenue un lieu d’affrontement entre les deux puissances régionales.
Au-delà de l’économie, la concurrence entre les deux pays porte sur l’influence politique, et leurs efforts d’aide au développement et de promotion des infrastructures cachent bien souvent des objectifs stratégiques. Si l’intérêt du gouvernement japonais pour l’aide au développement des infrastructures dans la région n’est pas une nouveauté, son approche a néanmoins changé au cours de dernières années sous la pression de la Chine, pour devenir en quelque sorte plus « stratégique ». En d’autres termes l’aide au développement japonaise dans la région s’est incontestablement « politisée ». Tel est peut-être là le principal impact du facteur chinois sur la posture japonaise dans la région du Mékong.
Ce document est disponible en anglais uniquement, téléchargeable ici.
Version WEB interactive de l'étude (en anglais). Cliquez ici pour l'afficher en taille réelle.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.














