1914-2014 : nation et nationalisme
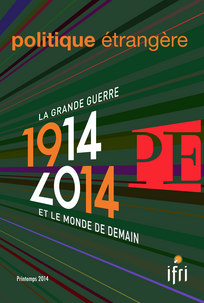
Les mobilisations de la Grande Guerre poussent leurs racines dans des imaginaires nationaux façonnés par le xixe siècle dans les pays d’Europe. Le double traumatisme des guerres mondiales engendre le déclin des nationalismes et la mise en place de nouvelles logiques de reconstruction des sociétés. La mondialisation remet encore en cause l’étroit cadre national, mais la crise actuelle de l’Union européenne montre que la démocratie a quelque mal à s’émanciper du cadre de la nation.

La tragédie de la Première Guerre mondiale est restée une énigme. On connaît tout de ses origines, ou presque. Cependant, la monstruosité des pertes en vies humaines qu’elle a engendrées dès les premières batailles, puis l’endurance des soldats et des civils aux années de souffrance et de deuil restent aujourd’hui encore incompréhensibles. Il n’est en tout cas pas facile de reconstruire l’univers mental des protagonistes de cette longue et abominable épreuve.
Les premiers mouvements de mobilisation de la guerre ont suscité de part et d’autre de grandes espérances collectives. Les témoignages de cette réalité sont concordants et innombrables : la presse, la littérature, les journaux intimes et les images de ces journées d’union nationale reflètent une espèce d’euphorie collective, élites et masses donnant l’impression de vivre une expérience communautaire quasiment mystique. On doit lire Stefan Zweig à cet égard, qui évoque « cet enthousiasme subit », après les craintes initiales d’une guerre que personne n’avait voulue. « Des cortèges se formaient dans les rues, partout s’agitaient des drapeaux, des rubans, des musiques retentissantes, les jeunes recrues défilaient triomphalement, le visage illuminé parce qu’on les acclamait, eux les petites gens de la vie quotidienne que personne n’avait jamais remarqué ni fêtés. » On sait que ce témoignage viennois est également éclairant pour Berlin et Paris.
Or après quelques semaines de guerre, à la fin de 1914, 300 000 Français étaient morts au front et 600 000 avaient été blessés. Le nombre des soldats allemands tombés au front était encore plus important. À Verdun, du 21 février 1916 au mois de décembre 1916, il y a un mort toutes les minutes du jour et de la nuit. L’offensive du Chemin des Dames, engagée par le général Nivelle le 16 avril 1917, entraîne la mort de 40 000 hommes en trois jours, du seul côté français. Cette bataille semble alors perdue, mais Nivelle s’obstine, et dans les semaines qui suivent quelque 150 000 hommes sont mis hors de combat par les mitrailleuses et les canons allemands. Ces carnages absurdes suscitent des mutineries.
Ils ne diminuent pas pour autant les ferveurs nationalistes de l’arrière. Dans L’Illustration du 28 avril 1917, Henri Lavedan écrit : « L’offensive, pour le soldat, c’est une période sublime de la guerre dans la guerre, une grande manœuvre, solennelle et sacrée entre toutes, pendant laquelle, plus encore que d’habitude, il cesse de s’appartenir et se livre tout entier. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Le nationalisme, creuset de la Grande Guerre
- Les après-coup du traumatisme
- L’obsolescence de l’État-nation
- Le déclin des solidarités nationales et la crise de l’Union européenne
- La démocratie peut s’émanciper de la nation
Pierre de Senarclens est professeur honoraire de relations internationales à l’université de Lausanne.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
1914-2014 : nation et nationalisme
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









