La Grande Guerre, en théories
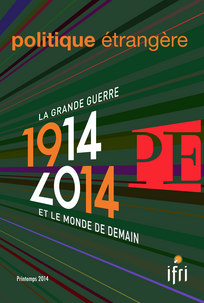
La Première Guerre mondiale a permis l’émergence de la discipline des relations internationales, mais ce sont la Seconde Guerre mondiale puis la guerre froide qui en ont favorisé le développement. Le premier conflit mondial demeure une réserve fertile d’exemples et d’arguments sur les causes et le déroulement de la guerre et de la paix. Mais sa place centrale dans cette discipline est contestée par la révolution nucléaire, la force des nationalismes ou le rôle nouveau du terrorisme.

Alors que les derniers vestiges de la Grande Guerre pourrissent, les universitaires continuent de s’en disputer la carcasse. Comme l’observe Dale Copeland : « La Première Guerre mondiale est probablement l’exemple le plus analysé et le plus controversé entre spécialistes des relations internationales. » Pour le meilleur ou pour le pire, consciemment ou non, ces débats ont structuré la manière dont nous pensons les problèmes actuels et concevons les politiques à venir.
Mais comment la Première Guerre mondiale marque-t-elle la réflexion sur les relations internationales ? Si elle a permis de poser les bases de la théorie moderne des relations internationales, ce sont la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, qui ont construit la discipline. La Grande Guerre a été une première étape décisive dans la recherche de la connaissance, mais comme étape d’un processus qui s’est accéléré une génération plus tard. Dans une certaine mesure, la Première Guerre mondiale nous permet encore de comprendre comment fonctionne notre monde ; d’un autre côté, elle n’est pas un exemple totalement pertinent dans un âge que marquent les armes nucléaires, le nationalisme désintégrateur et le terrorisme moderne.
Portraits d’époques
Pour saisir le legs de la Grande Guerre, il faut se référer à l’évolution de la pensée sur les relations internationales : un triptyque dont les trois panneaux sont séparés par la Première et la Seconde Guerres mondiales. Sur le premier panneau, chacun reconnaîtra les penseurs classiques des causes et de la conduite de la guerre : Hérodote, Thucydide, Xénophon, Machiavel et Clausewitz… Beaucoup reconnaîtront aussi que ces penseurs jouent le même rôle dans la science politique qu’Aristote, Léonard ou Newton dans les sciences actuelles. Certains relèveront peut-être que ces auteurs étaient des praticiens ou des historiens. Le deuxième panneau exhibe des visages moins familiers, une poignée de géopoliticiens et de protothéoriciens : Alfred Mahan, Halford John Mackinder, Friedrich Meinecke, Otto Hintze, Carl Schmitt, Edward Hallett Carr… Bien que beaucoup de ces auteurs soient encore des références, seuls Carr et Schmitt sont toujours largement lus. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Portrait d’époques
- La conduite de la guerre
- Causes de la guerre
- Causes de la paix
Joseph A. Karas est chercheur indépendant à Chicago, spécialiste de théorie des relations internationales et de psychologie politique.
Joseph M. Parent est maître assistant de science politique à l’université de Miami. Il a récemment publié : Uniting States: Voluntary Union in World Politics (New York, NY, Oxford University Press, 2011) et fera prochainement paraître: American Conspiracy Theories.
Traduit de l’anglais par Dorothée Cailleux.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La Grande Guerre, en théories
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?
L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.
Char de combat : obsolescence ou renaissance ?
Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.
Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine
La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.
« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza
Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.














