La place de l'Europe dans le monde : d'hier à demain
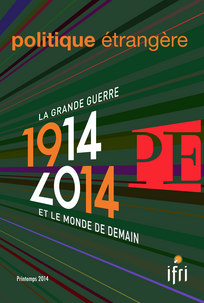
La première mondialisation du XXe siècle a produit un profond bouleversement de l’ordre des puissances et une dévalorisation globale des nations européennes. Elle a ainsi laissé le champ à une construction européenne largement technocratique et dépolitisée. Il est temps d’affirmer une vision nouvelle, fondée sur la coopération de nations qui demeurent en Europe le creuset de la démocratie. Seule une telle vision peut redonner à cette Europe son poids à l’international.

D’une mondialisation l’autre : entre la première mondialisation (1860-1911), sous égide britannique, et la seconde entamée après 1945 sous égide américaine, il y a en effet des différences, mais aussi beaucoup de similitudes, et par conséquent de leçons à tirer : l’une et l’autre visent la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et, dans une certaine mesure, des hommes. Dans les deux cas, le marché mondialisé a besoin d’un « patron », d’un hegemon qui en fasse respecter les règles : dans le premier cas, c’est la Grande-Bretagne maîtresse des mers, appuyée sur un empire qui concentre un cinquième de la population mondiale et attentive au maintien de l’équilibre européen. Dans la seconde mondialisation, ce sont les États-Unis avec leur avance technologique, leur surpuissance militaire, le réseau de leurs alliances et la projection mondiale de leurs multinationales.
Or, le mouvement même de la mondialisation induit dans les deux cas une profonde modification de la hiérarchie des puissances. Dans la première mondialisation, c’est la montée de l’Allemagne, après sa première unification, qui est le fait saillant dans l’ordre industriel et commercial. En 30 ans, elle triple sa production, alors que l’Angleterre la double et que la France ne l’accroît que d’un tiers. Dans la seconde mondialisation, le fait massif est la montée des « émergents » à partir des années 1990, au premier rang desquels la Chine, dont le produit national brut (PNB) rattrapera celui des États-Unis avant peu d’années.
La montée de l’Allemagne a commencé à inquiéter la Grande-Bretagne à partir de 1903. Celle-ci se rapproche alors de la France : c’est l’Entente cordiale de 1904. De même, les États-Unis prennent peu à peu conscience, dans les années 2000, de leur déficit commercial, de leur désindustrialisation croissante, de leur dépendance financière vis-à-vis de la Chine et de la montée en puissance, y compris militaire, de cette dernière. Ils opèrent, à partir de 2010, un pivotement de leur flotte de l’Atlantique vers le Pacifique, nouent des partenariats commerciaux transpacifique ou transatlantique, ou opèrent des rapprochements stratégiques en Asie, pour isoler la Chine. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Transfert d’hégémonie et dévalorisation des nations européennes
- Une autre logique pour la construction européenne
Jean-Pierre Chevènement est sénateur et ancien ministre. Il a récemment publié 1914-2014. L’Europe, sortie de l’Histoire ? (Paris, Fayard, 2013).
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La place de l'Europe dans le monde : d'hier à demain
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.









