Révolutions de l'an 1989 : fin d'un monde, naissance d'un siècle
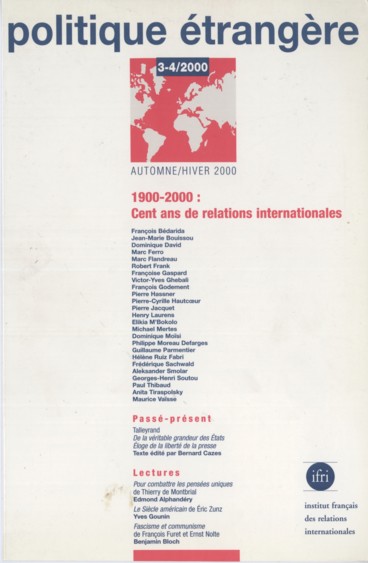
Que reste-t-il de l’année 1989 ? D’un côté, l’empire soviétique s’effondre, l’Europe de l’Est est libérée, la Yougoslavie se disloque, une kyrielle d’États s’édifient sur les ruines du communisme, et partout semble triompher le modèle occidental de développement économique, politique et social. Dix ans plus tard, l’euphorie des peuples a disparu ; l’héroïsme des libérateurs s’est plié au rigorisme des gestionnaires ; l’ouverture démocratique a parfois débouché sur la guerre ; et l’espoir des intellectuels accouché d’un renoncement au mythe de la troisième voie. À la charnière de deux époques, l’année 1989 semble avoir enfoui le souvenir du monde d’hier sous les turbulences du siècle nouveau, emmené par les États-Unis dans l’âge naissant de la globalisation.
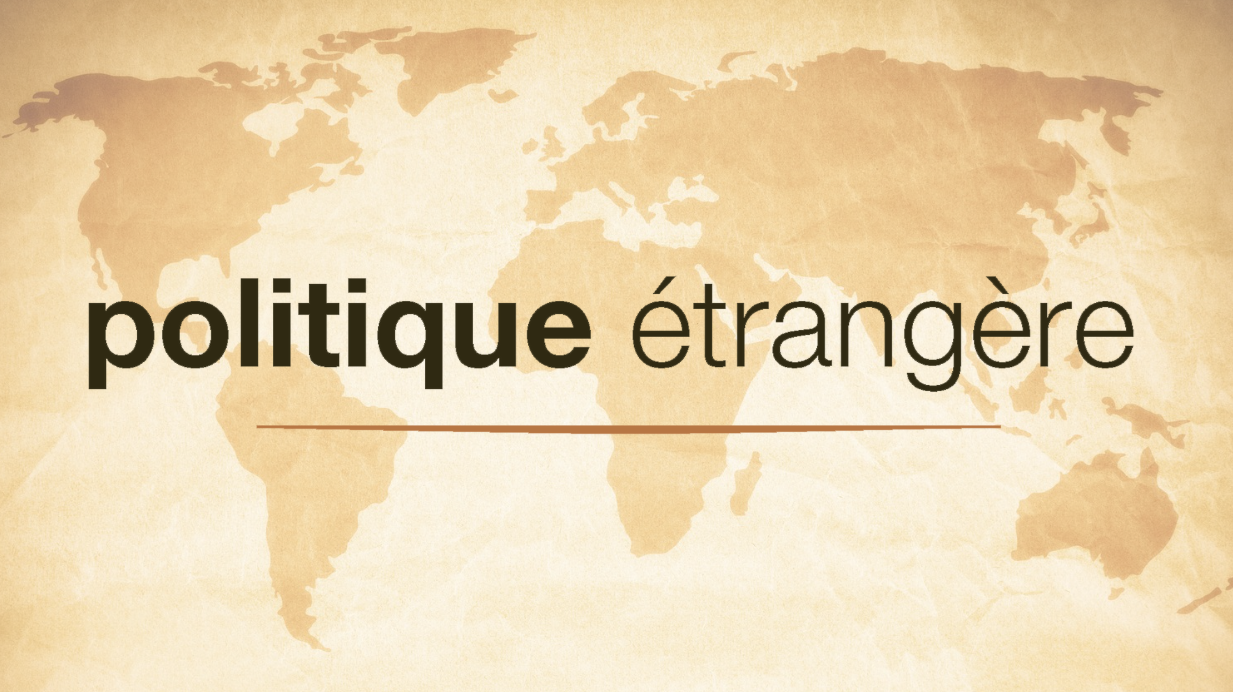
L'année 1989 commence par le retrait des armées soviétiques d'Afghanistan et se termine par la chute du régime Ceaucescu en Roumanie. Entre ces deux événements ont lieu les négociations entre l'opposition et le gouvernement en Pologne et en Hongrie qui conduisent, à terme, au démontage du communisme dans les deux pays. Puis le communisme s'effondre en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie. L'Union soviétique perd le contrôle de l'Europe centrale et orientale et entame son implosion, officialisée en 1991.
Il y a dix ans, le monde eut l'impression d'assister à des événements historiques majeurs, comparables à la Révolution française, à la révolution américaine, au printemps des peuples de 1848 ou à la révolution russe de 1917. Des décennies de guerre froide s'achèvent alors ; la menace de destruction totale prend fin ; un monde bétonné, bipolaire, s'évanouit. Pour les uns, ce grand chamboulement signifie « la fin de l'histoire » - au sens philosophique du terme -, une alternative à l'ordre libéral et démocratique paraissant inconcevable. Pour d'autres, l'histoire vient au contraire d'ouvrir grand ses portes : des pays, des peuples, des continents peuvent enfin modeler leur destin comme bon leur semble. D'autres encore craignent que cette année mémorable ne provoque des cataclysmes : chaos, guerres civiles, conflits ethniques... Le monde bipolaire garantissait, quoi qu'on en dise, une forme d'ordre et de prévisibilité. Constatant sa disparition, certains auteurs annoncent le retour des démons du passé. Pour de nombreux observateurs, le début des guerres yougoslaves est l'occasion de rappeler que les Première et Seconde Guerres mondiales comme la guerre froide ont commencé précisément sur ce bout de terre situé entre l'Orient et l'Occident, ancien carrefour des empires et de trois religions, la chrétienté occidentale, l'orthodoxie et l'islam.
Par ricochet, les événements de 1989 ont influencé la situation interne de l'Occident. La réunification allemande accélère l'intégration européenne, et l'expansion de la démocratie dans le monde s'accompagne d'une déstabilisation dans plusieurs vieux Etats démocratiques. Antérieurement, le sentiment de danger extérieur ne favorisait pas le questionnement critique de l'ordre politique. La concurrence systémique disparue, les États démocratiques ne peuvent compter que sur les sources intérieures de légitimité et les critères internes de succès ou d'échec. Leurs citoyens sont plus critiques face aux phénomènes qu'ils avaient tendance à tolérer auparavant, comme le manque de transparence ou la corruption. Aux côtés de la politique et de l'économie, l'importance des considérations éthiques semblent s'accroître sans cesse. […]
Aleksander Smolar est chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (Laboratoire d’analyse des systèmes politiques).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Révolutions de l'an 1989 : fin d'un monde, naissance d'un siècle
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








