Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées
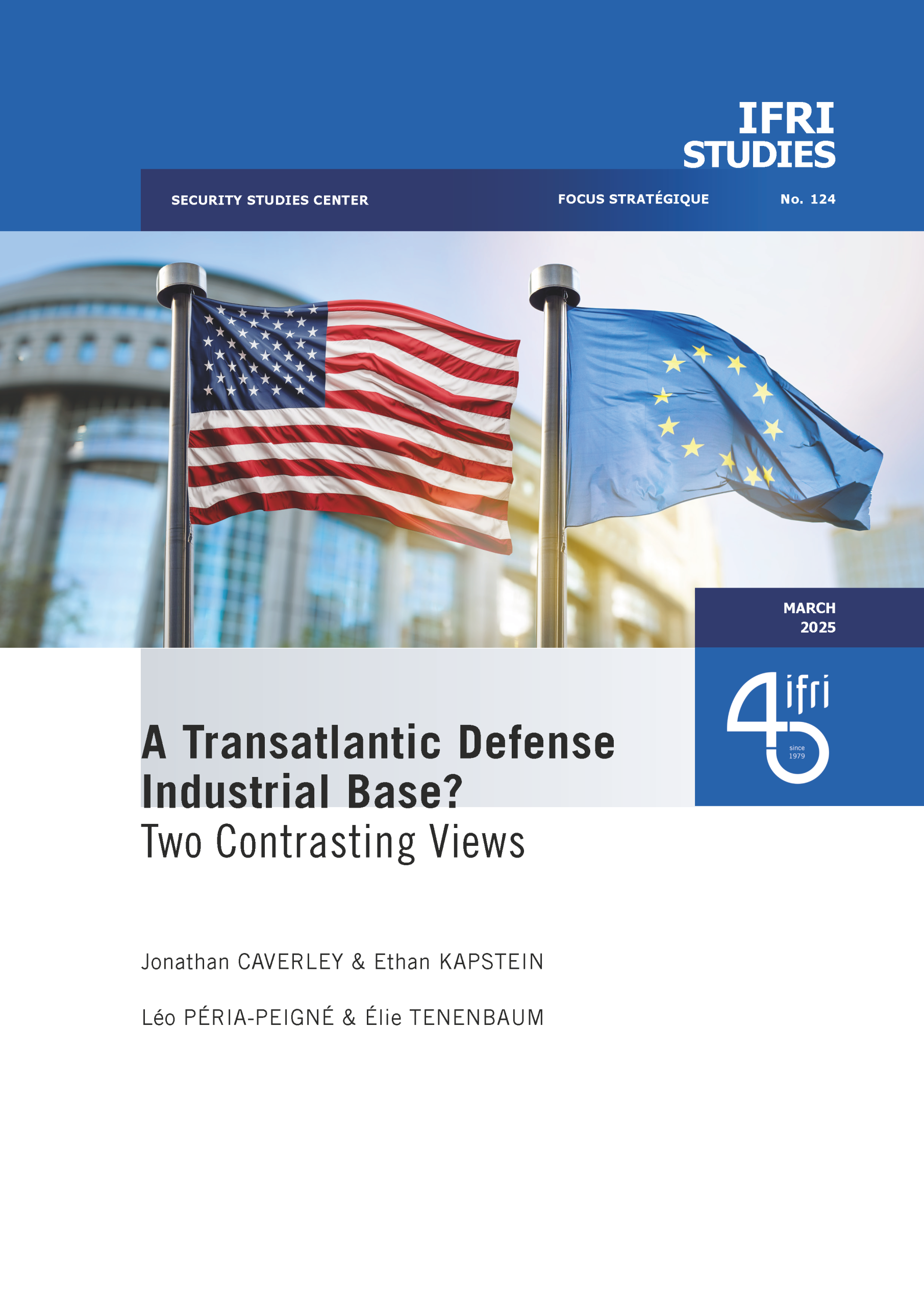
L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.
Le premier texte, rédigé par Jonathan Caverley et Ethan Kapstein, expose une analyse qui souligne les limites de l'autonomie stratégique européenne en matière de défense. Ils affirment qu'en dépit de l'augmentation des dépenses de défense et d'initiatives telles que le rapport Draghi, l'Europe reste fortement dépendante des États-Unis en matière de technologie militaire avancée et de capacités industrielles. Ils suggèrent que l'Europe devrait accepter un statut de partenaire junior au sein de l'Alliance transatlantique et tirer parti de la supériorité technologique des États-Unis pour renforcer ses propres capacités de défense. Selon eux, cette approche permettrait à l'Europe de bénéficier des systèmes de défense les plus avancés tout en reconnaissant les réalités économiques et industrielles qui limitent sa capacité à atteindre une autonomie totale.
Dans le second texte, Élie Tenenbaum et Léo Péria-Peigné remettent en question les études trop pessimistes sur l'industrie européenne de la défense. Ils soulignent les succès et les avancées technologiques des entreprises européennes de défense, affirmant que l'Europe a le potentiel pour devenir un acteur important sur le marché mondial de la défense. E. Tenenbaum et L. Péria-Peigné remettent en question la fiabilité des approvisionnements américains en matière de défense, évoquant les retards de production, les limitations opérationnelles et les contrôles stricts des exportations. Ils plaident pour un partenariat transatlantique plus équilibré, où l'Europe peut affirmer ses capacités industrielles et son autonomie stratégique tout en continuant à coopérer avec les États-Unis.
Au final, ces deux analyses, écrites par des chercheurs américains et européens, s'inscrivent dans le débat de plus en plus vif sur la coopération transatlantique en matière de défense. Ils explorent les tensions entre le besoin d'autonomie stratégique de l'Europe et les avantages de l'exploitation des forces technologiques et industrielles des États-Unis. Alors que l'Europe est confrontée au défi d'assurer sa sécurité dans un monde de plus en plus incertain, ces perspectives offrent un éclairage précieux sur l'avenir des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe.
Cette étude est uniquement disponible en anglais.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.

















