COP30 : un tournant décisif pour l'action et la gouvernance climatiques
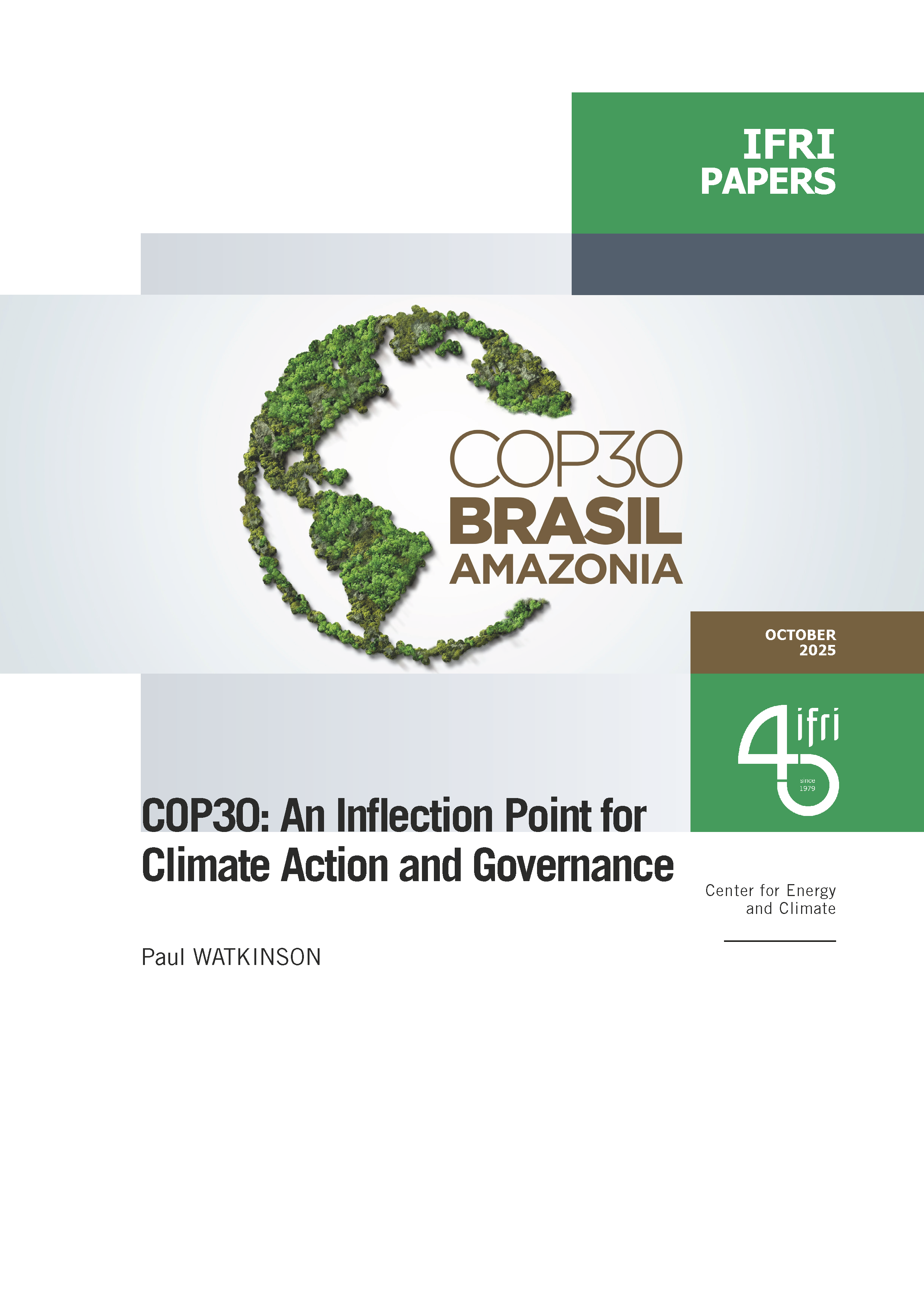
La 30e Conférence des Parties (COP30), qui s’ouvrira à Belém, au Brésil le 10 novembre 2025, se réunit à un moment périlleux.

Alors même que la crise climatique s’aggrave – l’année 2024 ayant été confirmée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant pour la première fois le seuil de 1, 5°C – l’action climatique recule dans l’agenda politique mondial en raison des tensions géopolitiques, de la montée du populisme, des pressions économiques et du retrait des États-Unis de l’accord de Paris, ce qui mine l’ordre multilatéral fondé sur des règles.
Des progrès ont été réalisés depuis l’adoption de l’accord de Paris il y a dix ans, notamment le déploiement des énergies renouvelables, dont les coûts ont chuté, et il est raisonnable d’espérer qu’un pic des émissions mondiales soit proche. Cependant, le monde reste encore loin des réductions rapides et soutenues nécessaires. La COP30 n’est pas une énième conférence sur le climat : c’est une occasion de réaffirmer l’engagement en faveur de l’action multilatérale pour le climat, malgré les vents contraires significatifs.
Au fil des trente ans passés, la COP s’est transformée d’une réunion technique en un événement mondial de grande ampleur, la COP28 à Dubaï ayant attiré plus de 80 000 participants. Cette croissance de la participation est principalement tirée par le développement de « l’agenda de l’action » – l’écosystème d’initiatives impliquant des acteurs non étatiques tels que les villes, les entreprises et la société civile, aux côtés des gouvernements et des organisations internationales.
Le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est désormais à un point d’inflexion. Avec l’accord de Paris et son corpus de règles détaillé pleinement opérationnel, l’ère des grandes négociations est largement achevée. La tâche centrale pour Belém et les futures COP n’est plus de créer des règles, mais d’accélérer leur mise en œuvre par la coopération et la collaboration afin d’aider à surmonter les obstacles concrets à l’action.
L’emplacement de Belém en Amazonie est symboliquement important, mais il soulève des défis logistiques, notamment une crise d’hébergement avec des prix en forte augmentation. Cela pose un risque d’exclusion pour les délégations des pays les plus pauvres et de la société civile, ce qui nuirait à l’inclusivité et à la légitimité de la Conférence.
L’agenda formel des négociations à Belém est chargé de travaux techniques importants, mais il lui manque le fait d’avoir un item « saillant ». Des décisions majeures sont attendues concernant l’établissement d’indicateurs pour suivre les progrès sur l’objectif mondial en matière d’adaptation, l’orientation du programme de travail sur la transition juste et plusieurs autres questions. Cependant, les discussions sur le financement et le suivi du premier bilan global devraient être épineuses.
Le plus grand défi pour Belém est politique : comment répondre à l’ambition insuffisante de la nouvelle série de contributions déterminées au niveau national (CDN) pour 2035. Les premières indications, y compris une annonce décevante de la Chine, suggèrent que l’ambition collective de ces nouveaux objectifs climatiques sera loin d’être compatible avec une trajectoire de 1,5 °C. Il est également nécessaire d’assurer la poursuite substantielle du nouvel objectif financier fixé l’année dernière et de démontrer une feuille de route pour mobiliser le financement pour les pays en développement malgré les réductions de soutien de la part des pays développés.
La présidence brésilienne a besoin de dégager un résultat qui mobilise le reste du monde.
Plusieurs stratégies sont possibles :
- Le leadership politique : le sommet prévu avant l’ouverture de la COP pourrait être utilisé pour générer des messages politiques forts et une dynamique auprès des chefs d’État et de gouvernement.
- Un résultat axé sur une approche traditionnelle : la présidence pourrait viser une décision politique de haut niveau qui exhorte toutes les Parties à « revoir et renforcer » leurs objectifs. Bien qu’importante, cela pourrait n’être guère plus que de la rhétorique.
- Un forum de mise en œuvre : restructurer « l’agenda de l’action » autour de thèmes clés issus du bilan global offre l’opportunité de mettre l’accent sur la concrétisation des ambitions et de placer un forum de mise en œuvre au cœur de la COP, couplé à un plan de suivi robuste pour assurer la traçabilité des progrès.
Une approche efficace pourrait combiner ces trois stratégies, en utilisant les feuilles de route existantes sur l’ambition et le financement (« Mission 1.5 » et la « Feuille de route de Bakou à Belém ») pour accélérer les progrès, et le pouvoir d’influence (ou soft power) de la COP pour impacter d’autres processus internationaux, tels que la réforme plus large de l’architecture financière internationale.
Les désaccords internes et l’instabilité mondiale ont mis la crédibilité de l’Union européenne (UE) sous la loupe. L’UE doit restaurer sa crédibilité en matière d’ambition en soumettant une CDN avec l’ambition la plus élevée possible et en ne diluant pas le Pacte vert (Green Deal) européen. Elle doit également garantir le financement climatique, renforcer les partenariats et soutenir le rôle des acteurs européens au-delà des gouvernements.
Belém peut marquer le début d’une évolution indispensable du processus de la COP, en déplaçant l’accent vers la mise en œuvre, en améliorant l’efficacité du processus formel de la COP et en bâtissant des liens plus solides avec le reste du système des Nations unies.
> Cette publication est uniquement disponible en anglais: « COP30: An Inflection Point for Climate Action and Governance ».

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesQuels instruments financiers pour renforcer la résilience des chaînes de valeur des métaux critiques et le stockage stratégique ?
Les chaînes de valeur des matières premières critiques sont plus vulnérables que jamais et des secteurs industriels vitaux en Europe sont désormais menacés si leurs approvisionnements ne sont pas sécurisés par des mesures stratégiques et urgentes, compte tenu de l'intensification des confrontations géopolitiques, du nationalisme en matière de ressources, de la demande croissante et de l'augmentation limitée de l'offre.
L'UE en état d'alerte : priorité sur les enjeux énergétiques et industriels pour 2026
L'année 2025 a confirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un environnement géoéconomique et géopolitique plus difficile, car l'intensité et la fréquence des chocs augmentent, tandis que l'Union européenne (UE) n'a plus de flancs stables, dans un contexte de fréquentes crises avec les États-Unis, révélatrices d’une fracture systémique.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques
La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.













