La France et son rapport au monde au XXe siècle
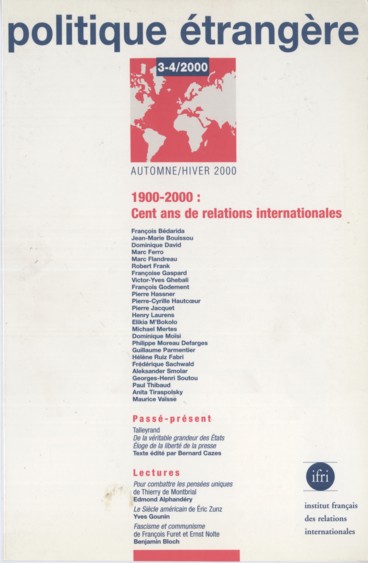
Depuis Louis XIV, 1789 et Napoléon, la France poursuit un rêve de grandeur. Après la défaite contre l’Allemagne, en 1870, ce rêve se brise une première fois, et les deux guerres mondiales accentuent le sentiment de déclin qui se développe tout au long du XXe siècle. Perdant son statut de grande puissance après 1940, la France se donne un nouveau rôle sous l’impulsion du général de Gaulle : mise en place d’une force de dissuasion nucléaire, sortie des structures intégrées de l’OTAN, politique de la chaise vide à Bruxelles, coopération avec les pays africains et arabes. Mais la fin de la guerre froide et la construction européenne remettent en cause l’héritage gaullien. Le renforcement de l’intégration européenne, sous François Mitterrand, et la 'révolution stratégique', opérée par Jacques Chirac, permettent peut-être enfin à la France d’aujourd’hui de renoncer au mythe de la grandeur pour jouer avec réalisme le rôle qui lui revient au sein d’une grande Europe.
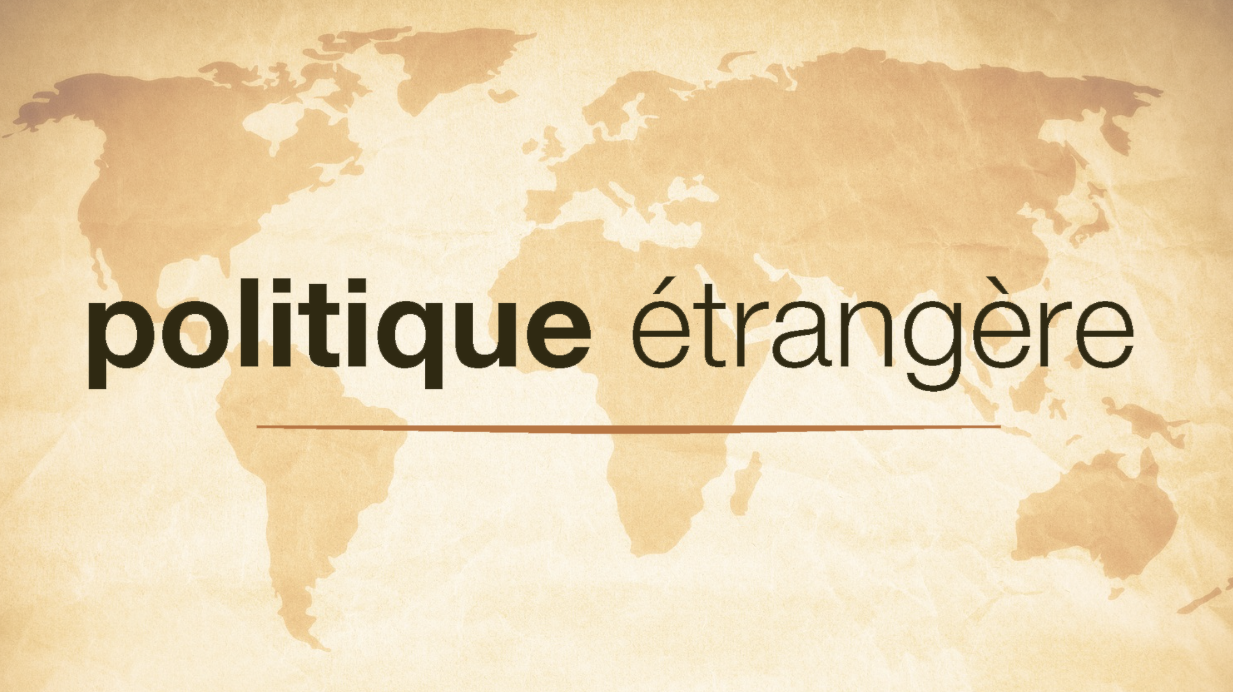
La France entretient avec le monde une relation toute spéciale, suscitant l'admiration de certains et l'agacement de beaucoup : elle se veut et se voit « grande » depuis des siècles, et elle pense, surtout depuis 1789, avoir des choses à dire à l'univers, un message à lui délivrer, une mission à remplir. Puisque la « grande nation » éprouve, au plus profond de sa conscience collective, un besoin de grandeur, elle ressent aussi une forte nostalgie, lorsqu'elle entrevoit que son rôle n'est plus ce qu'il était.
Précisément, le XXe siècle n'est-il pas pour notre pays le temps dramatique de l'incertitude et du doute ? Un sentiment de déclin hante les Français depuis longtemps : il se renforce après la défaite de 1870- 1871, continue de se développer en dépit de la victoire de 1918 et culmine enfin dans les années qui suivent la débâcle de 1940. Pendant une grande partie du siècle, le rang de la France est en péril : jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, son statut de grande puissance est menacé, puis il est perdu, même si le général de Gaulle tente après 1958 de lui redonner un rôle. Dès lors que sa position internationale est en question, la tentation n'est-elle pas grande de prendre des postures qui la rassurent plus qu'elles ne renforcent son influence dans le monde ?
Mauvaises positions
La position de la France s'est modifiée au cours du XXe siècle, mais on trouve au moins deux éléments de longue continuité : l'angoisse pour sa sécurité en Europe se traduit pendant des décennies par l'obsession du « danger allemand » ; l'ambition de jouer un rôle mondial induit la nécessité de gérer des relations souvent difficiles avec les Anglo-Saxons.
Le spectre de l'insécurité : l'obsession allemande de la France
Si, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, la France, véritable superpuissance avant la lettre, peut tenir tête à toute l'Europe, les invasions et les défaites de 1814-1815 lui portent un coup dur. Mais dans les années qui suivent, sa sécurité ne connaît pas de péril majeur. L'équilibre européen établi par le Congrès de Vienne et la Sainte- Alliance viennent en effet lui rappeler, sur un mode certes péniblement « réactionnaire », que la paix dépend seulement de sa résignation à ne pas recommencer à se soucier de la liberté des autres. La menace pour l'Europe est présentée comme « française » et aucun autre danger ne point à l'horizon.
Le tournant essentiel intervient avec l'unité allemande, conquise par Bismarck lors de la guerre victorieuse contre la France en 1870-1871. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Mauvaises positions
- Le spectre de l'insécurité : l'obsession allemande de la France
- La hantise du déclin : la pression anglo-saxonne
- Belles postures
- La France et son mal du siècle
- De Gaulle sort la France du syndrome de quarante
- Sortir de l'héritage gaullien
Robert Frank est ancien directeur de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS) et professeur d’histoire des relations internationales contemporaines à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La France et son rapport au monde au XXe siècle
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesAvant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.








