En marge des combats douteux
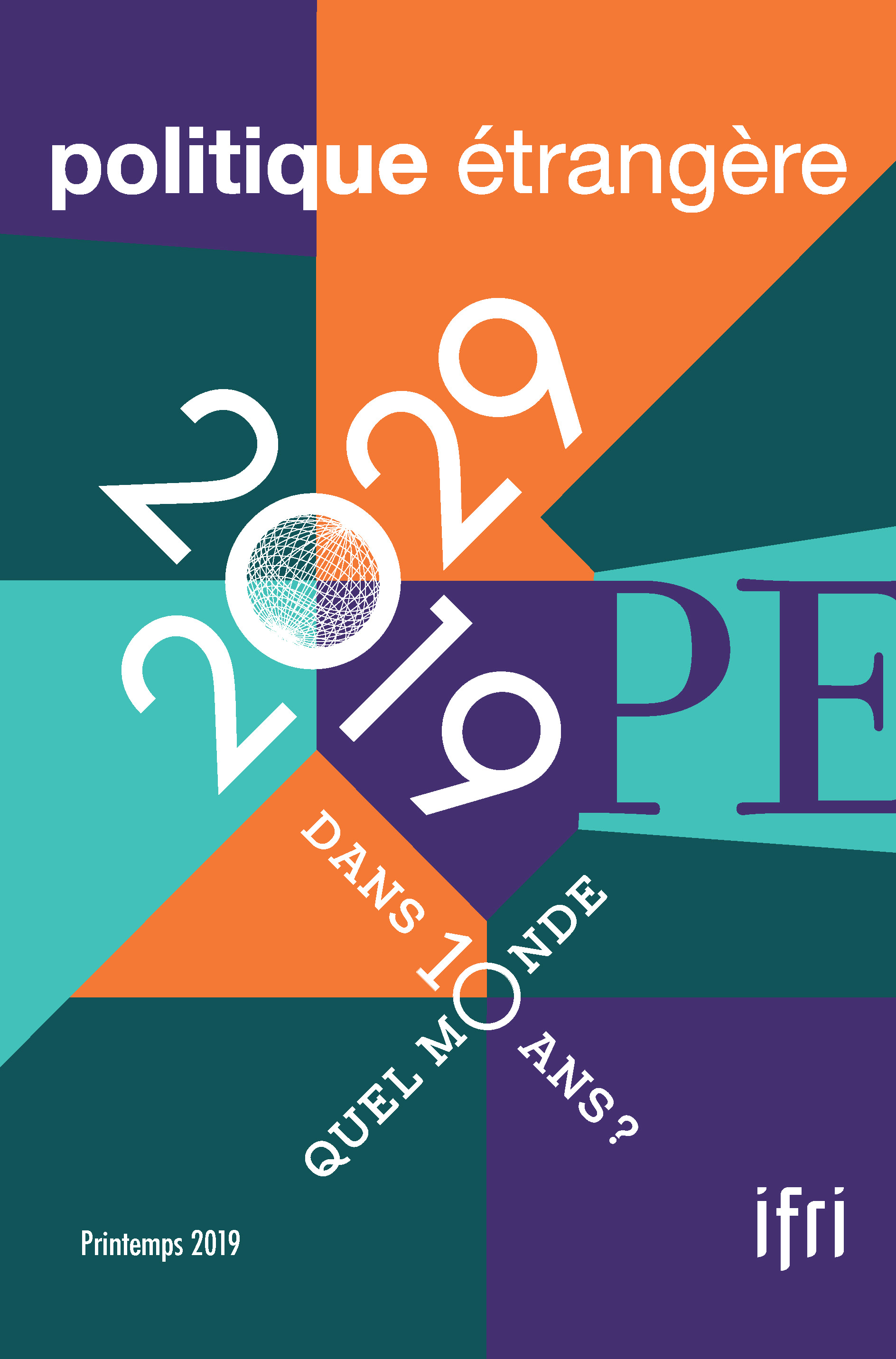
Ce texte a été publié dans Politique étrangère en 1979, année de création de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Raymond Aron y revient sur des événements importants de la décennie écoulée, comme la guerre du Vietnam. Il développe surtout une réflexion générale sur la place du droit, de la morale, de la force et de l’intérêt national dans les relations internationales. En filigrane apparaissent dans ce texte des thématiques proches du droit d’ingérence ou de la responsabilité de protéger.

Les Français en 1954, les Américains en 1973 ont quitté les trois pays de la péninsule indochinoise, désormais soumis à des partis qui se réclament de la même idéologie. Et les guerres continuent, tantôt entre des armées, tantôt entre une armée et des maquisards. Le retrait des Occidentaux n’a pas laissé les peuples à eux-mêmes, à leur volonté d’indépendance ou à leurs querelles. Naguère impliqués par le conflit Est-Ouest, voici les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, objet de la rivalité entre les deux Grands du marxisme-léninisme.
L’analyste désireux de marquer des points contre le marxisme-léninisme trouve là des occasions propices. Les combattants professent la même doctrine qu’ils réfutent par leurs actes. Le capitalisme par essence impérialiste, le socialisme par essence pacifique : comment accorder ces articles du dogme avec l’expérience ? Les Viets et les Khmers rouges, alliés contre les Américains et les gouvernements soutenus par eux, semblent avoir prévu la nouvelle épreuve de force dès le jour de la victoire commune. Les Chinois avaient soutenu, ravitaillé le régime de Hanoï aussi bien pendant la première guerre contre les Français que pendant la deuxième contre les « fantoches » de Saigon et les États-Unis. Quatre années après la chute de Thieu, voici les Vietnamiens étroitement liés à Moscou, intégrés au Conseil d’assistance économique mutuelle (Comecon) et, du même coup, tenus pour ennemis par les Chinois, formidable voisin auquel ils ont résisté pendant des siècles.
La rivalité Est-Ouest obéissait à des règles non écrites, plus ou moins respectées. La plus rarement violée était celle qui interdisait le franchissement des frontières par des armées régulières. Il semble qu’elle n’inspire plus le respect. Les troupes de l’Inde, gouvernée à l’époque par madame Gandhi, franchirent la frontière de la province orientale du Pakistan, province en révolte contre le pouvoir dit central, établi à Islamabad, à quelque 3 000 kilomètres du Bengale. Fallait-il accuser l’ex-« impératrice de l’Inde » d’agression ? Formellement, à coup sûr. Mais quel était l’autre terme de l’alternative ? Les électeurs de ce qui est devenu le Bangladesh avaient voté massivement pour le parti autonomiste. Les négociations entre le général Yahya Khan et le cheikh Mujibur Rahman, le chef du parti autonomiste, le père de la patrie (depuis lors assassiné) avaient échoué. Ce dernier avait été jeté en prison ; la révolte avait éclaté, la répression aussi ; les insurgés de la province orientale avaient proclamé leur État et entamé la résistance et la guérilla. […]
Raymond Aron (1905-1983) a notamment été professeur au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Il est l’auteur d’ouvrages de référence sur les relations internationales, dont Paix et guerres entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 84, n° 1, printemps 2019

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
En marge des combats douteux
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.











