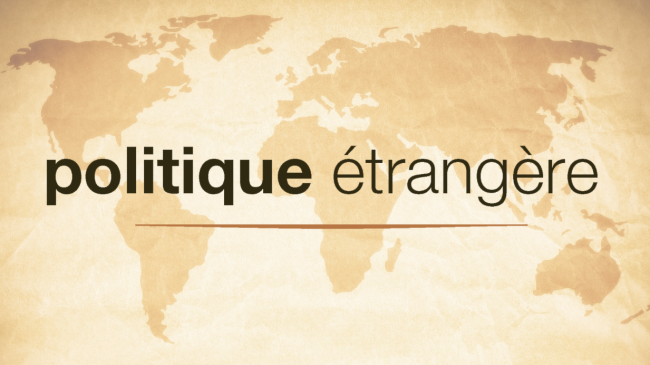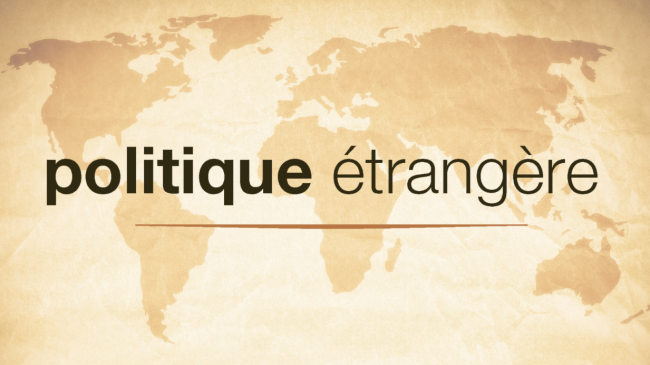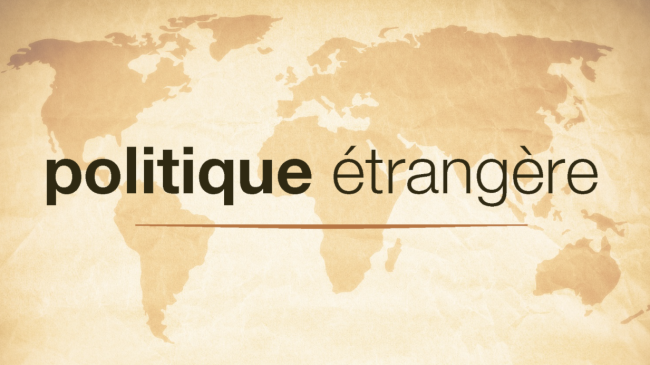La Russie face à la mondialisation : la voie du trans-impérialisme
Grâce à ses ressources énergétiques, la Russie est de retour dans l’économie mondiale dans son voisinage proche, et dans le rapport global des puissances. Elle n’est ni post-impériale, ni néo-impériale. Elle peut plutôt être qualifiée de trans-impériale, en ce sens qu’elle tente de reproduire à l’échelle internationale le système des relations patrons-clientèle qui structurent l’actuel pouvoir à Moscou. Ce trans-impérialisme appelle une réponse coordonnée entre Europe et États-Unis.
Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation
Abdou Diouf a commencé sa carrière politique au Sénégal. Il a été directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor puis Secrétaire général de la Présidence de la République. En 1970, il est nommé Premier ministre. En 1981, il est élu président de la République, fonction qu'il occupe jusqu'en 2000. De 2003 à 2014, il est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).
Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide
L’effondrement de l’Union soviétique a considérablement modifié les pratiques des relations internationales et a suscité des débats théoriques qui se poursuivent encore. L’école réaliste, dominante pendant la guerre froide, a été remise en cause par les tenants du transnationalisme. Chaque courant de pensée permet, à sa manière, d’éclairer le monde dans lequel nous vivons, et les théories doivent être perçues davantage comme des outils interprétatifs que comme des dogmes infaillibles.
Mythologies de l'international
La culture internationale contemporaine est imprégnée de mythes. Trois d’entre eux occupent une place particulière: celui de l’universel, celui de la paix et celui de la suprématie du droit. Les mythes peuvent être bénéfiques à condition de ne pas oublier qu’ils ne sont que des interprétations et non des vérités absolues. C’est précisément cet oubli qui pourrait porter préjudice aux Occidentaux, créateurs et exportateurs des principales mythologies de l’international.
Comment la globalisation façonne le monde
La globalisation et ses conséquences en matière de finance et de commerce internationaux ont de puissants effets sur les économies nationales. Elles favorisent la progression des pays émergents; laissent peu de place aux autres pays du Tiers-Monde, réduits à attendre que les émergents délocalisent ce qu’ils n’entendent plus faire; et accroissent partout les inégalités économiques internes. Ces inégalités, ainsi que les pressions migratoires, sont les débats pressants de ce monde globalisé.
Mondialisation : la vraie rupture du XXe siècle
Au-delà de comparaisons faciles entre la fin du XIXe et celle du XXe siècle, cet article s’attache à montrer combien la mondialisation économique diffère de l’internationalisation du siècle précédent, par son intensité et par sa complexité. Il analyse le choc qu’a représenté pour les économies de la fin du XIXe siècle la convergence des prix et des salaires, liée à l’internationalisation, et la réponse alors apportée par les gouvernements. Comparant les mouvements de rejet suscités par les deux phénomènes, il explique pourquoi l’opposition contemporaine à la mondialisation a mis plus longtemps à se manifester et souligne le rôle fondamental du contexte institutionnel, national et international. À cet égard, les oppositions actuelles à la mondialisation placent au coeur des préoccupations d’aujourd’hui les conditions mêmes de sa gouvernance.
La politique étrangère à l'épreuve de la mondialisation
Longtemps monopolisée par des diplomates issus des plus hautes strates de la société, la diplomatie a connu de profonds bouleversements depuis la fin de la Première Guerre mondiale : extension du champ de son domaine d’action, diversification et multiplication des acteurs du jeu diplomatique, dialectique entre les gouvernements, les entreprises et les médias, dialogue avec la société civile, etc. Une évolution positive à bien des égards, mais qui risque aussi d’entraîner des confusions entre moralité et démagogie, tactique électoraliste et stratégie politique.
Révolutions de l'an 1989 : fin d'un monde, naissance d'un siècle
Que reste-t-il de l’année 1989 ? D’un côté, l’empire soviétique s’effondre, l’Europe de l’Est est libérée, la Yougoslavie se disloque, une kyrielle d’États s’édifient sur les ruines du communisme, et partout semble triompher le modèle occidental de développement économique, politique et social. Dix ans plus tard, l’euphorie des peuples a disparu ; l’héroïsme des libérateurs s’est plié au rigorisme des gestionnaires ; l’ouverture démocratique a parfois débouché sur la guerre ; et l’espoir des intellectuels accouché d’un renoncement au mythe de la troisième voie. À la charnière de deux époques, l’année 1989 semble avoir enfoui le souvenir du monde d’hier sous les turbulences du siècle nouveau, emmené par les États-Unis dans l’âge naissant de la globalisation.
100 ans de Chine : de la révolte des Boxers au grand pas en avant vers l'intégration globale
1900, 2000 : deux dates clefs dans l’histoire de la Chine. 1900, c’est l’année de la révolte des Boxers et de la répression occidentale qui s’ensuit. 2000 voit au contraire la République populaire frapper à la porte de l’OMC et adopter une série de réformes économiques, juridiques et culturelles qui trouvent souvent leur inspiration en Occident. À bien des égards, pourtant, la Chine d’aujourd’hui a conservé la marque de celle de l’impératrice Cixi : le nationalisme chinois reste vif aussi bien dans les relations avec Taiwan que dans le reste de l’Asie ; et les élites comme la population restent partagées entre l’aspiration à la modernité et la peur de l’interdépendance induite par le processus mondial de globalisation. Mais l’avenir de la Chine est peut-être ailleurs : dans la participation à la constitution d’ensembles régionaux aux côtés de l’Europe ou de l’Amérique latine, plutôt que dans une course à la superpuissance avec les États-Unis qui semble déjà perdue.
Replay - Un nouvel échiquier. Présentation du Ramses 2026
Replay de la conférence de présentation du Ramses 2026 - Un échiquier mondial haché par les vertiges de puissance. Un spectre hante le monde : la fragmentation - après des décennies chantant l'ouverture et l'unification sous le signe du progrès technique et de l'accélération des échanges. On passerait ainsi d'un espace mondialisé à un espace haché, émietté en égoïsmes nationaux, intérêts égoïstes insoucieux des autres, effaçant au passage l'espoir d'une gouvernance faisant écho aux intérêts communs d'une humanité unie.
La Russie face à la mondialisation : la voie du trans-impérialisme
Grâce à ses ressources énergétiques, la Russie est de retour dans l’économie mondiale dans son voisinage proche, et dans le rapport global des puissances. Elle n’est ni post-impériale, ni néo-impériale. Elle peut plutôt être qualifiée de trans-impériale, en ce sens qu’elle tente de reproduire à l’échelle internationale le système des relations patrons-clientèle qui structurent l’actuel pouvoir à Moscou. Ce trans-impérialisme appelle une réponse coordonnée entre Europe et États-Unis.
Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation
Abdou Diouf a commencé sa carrière politique au Sénégal. Il a été directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor puis Secrétaire général de la Présidence de la République. En 1970, il est nommé Premier ministre. En 1981, il est élu président de la République, fonction qu'il occupe jusqu'en 2000. De 2003 à 2014, il est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).
Comment la globalisation façonne le monde
La globalisation et ses conséquences en matière de finance et de commerce internationaux ont de puissants effets sur les économies nationales. Elles favorisent la progression des pays émergents; laissent peu de place aux autres pays du Tiers-Monde, réduits à attendre que les émergents délocalisent ce qu’ils n’entendent plus faire; et accroissent partout les inégalités économiques internes. Ces inégalités, ainsi que les pressions migratoires, sont les débats pressants de ce monde globalisé.
Mythologies de l'international
La culture internationale contemporaine est imprégnée de mythes. Trois d’entre eux occupent une place particulière: celui de l’universel, celui de la paix et celui de la suprématie du droit. Les mythes peuvent être bénéfiques à condition de ne pas oublier qu’ils ne sont que des interprétations et non des vérités absolues. C’est précisément cet oubli qui pourrait porter préjudice aux Occidentaux, créateurs et exportateurs des principales mythologies de l’international.
Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide
L’effondrement de l’Union soviétique a considérablement modifié les pratiques des relations internationales et a suscité des débats théoriques qui se poursuivent encore. L’école réaliste, dominante pendant la guerre froide, a été remise en cause par les tenants du transnationalisme. Chaque courant de pensée permet, à sa manière, d’éclairer le monde dans lequel nous vivons, et les théories doivent être perçues davantage comme des outils interprétatifs que comme des dogmes infaillibles.
Mondialisation : la vraie rupture du XXe siècle
Au-delà de comparaisons faciles entre la fin du XIXe et celle du XXe siècle, cet article s’attache à montrer combien la mondialisation économique diffère de l’internationalisation du siècle précédent, par son intensité et par sa complexité. Il analyse le choc qu’a représenté pour les économies de la fin du XIXe siècle la convergence des prix et des salaires, liée à l’internationalisation, et la réponse alors apportée par les gouvernements. Comparant les mouvements de rejet suscités par les deux phénomènes, il explique pourquoi l’opposition contemporaine à la mondialisation a mis plus longtemps à se manifester et souligne le rôle fondamental du contexte institutionnel, national et international. À cet égard, les oppositions actuelles à la mondialisation placent au coeur des préoccupations d’aujourd’hui les conditions mêmes de sa gouvernance.
Révolutions de l'an 1989 : fin d'un monde, naissance d'un siècle
Que reste-t-il de l’année 1989 ? D’un côté, l’empire soviétique s’effondre, l’Europe de l’Est est libérée, la Yougoslavie se disloque, une kyrielle d’États s’édifient sur les ruines du communisme, et partout semble triompher le modèle occidental de développement économique, politique et social. Dix ans plus tard, l’euphorie des peuples a disparu ; l’héroïsme des libérateurs s’est plié au rigorisme des gestionnaires ; l’ouverture démocratique a parfois débouché sur la guerre ; et l’espoir des intellectuels accouché d’un renoncement au mythe de la troisième voie. À la charnière de deux époques, l’année 1989 semble avoir enfoui le souvenir du monde d’hier sous les turbulences du siècle nouveau, emmené par les États-Unis dans l’âge naissant de la globalisation.
La politique étrangère à l'épreuve de la mondialisation
Longtemps monopolisée par des diplomates issus des plus hautes strates de la société, la diplomatie a connu de profonds bouleversements depuis la fin de la Première Guerre mondiale : extension du champ de son domaine d’action, diversification et multiplication des acteurs du jeu diplomatique, dialectique entre les gouvernements, les entreprises et les médias, dialogue avec la société civile, etc. Une évolution positive à bien des égards, mais qui risque aussi d’entraîner des confusions entre moralité et démagogie, tactique électoraliste et stratégie politique.
100 ans de Chine : de la révolte des Boxers au grand pas en avant vers l'intégration globale
1900, 2000 : deux dates clefs dans l’histoire de la Chine. 1900, c’est l’année de la révolte des Boxers et de la répression occidentale qui s’ensuit. 2000 voit au contraire la République populaire frapper à la porte de l’OMC et adopter une série de réformes économiques, juridiques et culturelles qui trouvent souvent leur inspiration en Occident. À bien des égards, pourtant, la Chine d’aujourd’hui a conservé la marque de celle de l’impératrice Cixi : le nationalisme chinois reste vif aussi bien dans les relations avec Taiwan que dans le reste de l’Asie ; et les élites comme la population restent partagées entre l’aspiration à la modernité et la peur de l’interdépendance induite par le processus mondial de globalisation. Mais l’avenir de la Chine est peut-être ailleurs : dans la participation à la constitution d’ensembles régionaux aux côtés de l’Europe ou de l’Amérique latine, plutôt que dans une course à la superpuissance avec les États-Unis qui semble déjà perdue.
La mondialisation vue de Pékin
La présidence de Xi Jinping a mis fin à une longue période où la Chine faisait profil bas dans les relations internationales.
Des émergents au défi du "retour de la géopolitique": Côte d'Ivoire, Nigeria, Brésil, Indonésie
A l’occasion de la deuxième session de "Ifri-OCP Policy Center Roundtables" sur les émergents au défi du "retour de la géopolitique", tenue le vendredi 22 mai 2015 à Paris, intervenants et experts se sont réunis pour discuter du rapport entre émergence et puissance pour le cas nigérian, ivorien, brésilien et indonésien.
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.