L'héritage de la Grande Guerre : États souverains, mondialisation et régionalisme
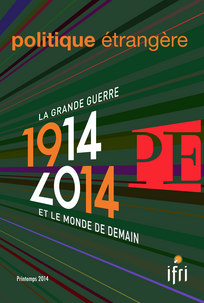
La Grande Guerre modèle nombre de pratiques et de normes du xxe siècle. La prééminence économique et sociale de l’État s’y confirme, comme la montée de valeurs nouvelles : l’universalité des Droits de l’homme, la construction collective d’une sécurité jusqu’ici dépendante d’alliances bilatérales, l’élaboration de normes juridiques universelles... La Grande Guerre nous lègue à la fois un État-nation réaffirmé et la possibilité de son dépassement dans l’organisation régionale et internationale.

La Grande Guerre a été la matrice du XXe siècle et nombre de ses effets à long terme perdurent, pour le meilleur comme pour le pire. Elle a produit une nouvelle vision de la guerre : la quantité des morts est devenue qualité, correspondant à une nouvelle forme de guerre, la guerre totale. En retour, l’horreur du conflit a suscité la première remise en cause, sur une grande échelle, de la légitimité même de la guerre. Elle a profondément modifié les équilibres en Europe et dans le monde et bouleversé l’économie, comme les relations entre les États et leurs citoyens. Elle a engendré aussi une crise morale et la remise en cause de bien des valeurs et de bien des paradigmes. Elle a beaucoup contribué à l’apparition des deux grands totalitarismes, le national-socialisme allemand et le communisme soviétique. Si ces derniers ont disparu, leurs conséquences perdurent.
En même temps, car en histoire les évolutions s’entremêlent toujours – « mixta permixta », disait saint Augustin –, la guerre de 1914-1918 a permis ou accéléré de nouveaux développements, toujours actuels : le début d’une nouvelle organisation internationale, une nouvelle compréhension de l’État-nation, de nouveaux paradigmes économiques et sociaux, l’ébauche d’un nouveau droit des gens.
Son héritage est donc profondément contradictoire, et cette contradiction détermine largement les paramètres du monde de 2014. D’une part, la Première Guerre mondiale a accéléré un mouvement de mondialisation évident depuis le milieu du XIXe siècle, en y impliquant la plupart des peuples, y compris ceux qui se trouvaient sous la domination coloniale de l’Europe, pesant ainsi sur l’ensemble de l’économie mondiale, suscitant les premiers essais d’organisation internationale, multipliant la force des courants politiques, moraux et culturels internationalistes, posant les premières bases d’un droit des gens nouveau fondé sur des valeurs universelles et commençant le mouvement de judiciarisation de la vie internationale. En revanche, elle a généralisé la formule d’organisation des États-nations souverains, jusque-là réservée à certains États européens. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- L’Etat Moloch
- Une étape vers la démocratie et le Welfare State
- La guerre délégitimée, le mercantilisme rejeté
- La montée des valeurs, l’affirmation universelle des Droits de l’homme
- Une nouvelle organisation des relations internationales : la Grande Guerre développe et structure la mondialisation
- Entre réalisme et normes juridiques universelles
- 1914-2014 : triomphe de l’Etat-nation démocratique et survie du système westphalien
- La progression discrète du régionalisme depuis 1914
- Les contradictions du siècle écoulé sont toujours actuelles
Georges-Henri Soutou, historien, membre de l’Institut, est professeur émérite à la Sorbonne.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'héritage de la Grande Guerre : États souverains, mondialisation et régionalisme
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.









