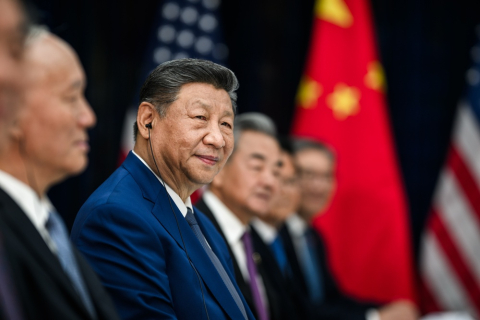Guerre au Moyen-Orient : point de situation à J+12 (replay visioconférence)
Au douzième jour d'une campagne militaire d'une intensité inédite contre l'Iran menée par les États-Unis et Israël, le Moyen-Orient bascule dans une configuration géopolitique nouvelle. Les experts de l'Ifri examinent les ramifications de ce conflit.
Titre bloc à la une
À la une
Voir toutes nos analyses
La base et les élites MAGA face à l’opération Epic Fury. Le soutien au président tiendra-t-il dans la durée?
Depuis la fin du mois de février, le Moyen-Orient est de nouveau déchiré par la guerre, à la suite de la vaste offensive aérienne menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. L’opération, baptisée Epic Fury, a notamment permis, dès le premier jour, l’élimination de dizaines de hauts responsables iraniens.
Moyen-Orient : pourquoi ce nouveau conflit n’a pas grand-chose à voir avec la guerre des Douze jours de juin dernier
Le conflit qui oppose les États-Unis et Israël à l’Iran est dorénavant plus long que la précédente opération armée confrontant les trois protagonistes en juin 2025, dénommée « guerre des Douze jours » par Donald Trump.
« Le recours à l’IA dans le cadre des opérations militaires marginalise la prise de décision humaine »
Dans une tribune au « Monde », la directrice du Centre géopolitique des technologies de l’Ifri estime que l’ampleur et la succession des actions menées par l’intelligence artificielle sur les terrains de guerre rendent les opérations trop rapides pour être appréhendées par un esprit humain.

Événements à venir
Quelle politique de défense en Allemagne ?
Quel partenariat technologique avec l’Inde ?
Titre
En ce moment
Titre
À regarder et écouter


Zohran Mamdani : la gauche new-yorkaise face à l'Amérique de Donald Trump, avec Tristan Cabello
L'élection du nouveau maire démocrate de New York fait naître l'espoir d'une dynamique progressiste renouvelée à travers le pays.


Le Japon de Takaichi : une diplomatie menée tambour battant
Octobre 2025 : Sanae Takaichi devient la première femme à accéder au poste de Premier ministre du Japon. Quelques mois plus tard, elle remporte des élections anticipées avec deux tiers des sièges à la chambre basse, un résultat sans précédent depuis les années 1950.

Dissuasion nucléaire : l’offre de la France à l’Europe
Le 2 mars à l'Ile Longue, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement de la dissuasion nucléaire française, désormais élargie à l'Europe. Quelles sont les conditions de cette dissuasion avancée ? Signerait-elle la fin du parapluie nucléaire américain en Europe ?

La guerre au Moyen-Orient menace-t-elle l'économie mondiale ?
Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit, les mauvais souvenirs des répercussions énergétiques et économiques de la guerre en Ukraine refont surface. Faut-il craindre un deuxième épisode d’inflation des prix de l’énergie? La France et les pays européens pourront-ils faire face ?
Titre mis en avant
Écoutez le podcast « Le monde selon l'Ifri » !
Présenté par Marc Hecker, directeur exécutif de l'Ifri, ce podcast livre des clés de compréhension des enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. 2 épisodes sortent chaque mois.

Comprendre le monde d'aujourd'hui pour mieux préparer demain

Depuis plus de 45 ans, l’Ifri place les relations internationales au centre des discussions au profit de l’intérêt général.
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.