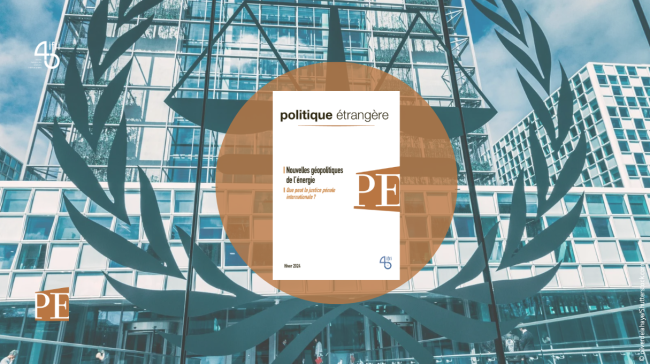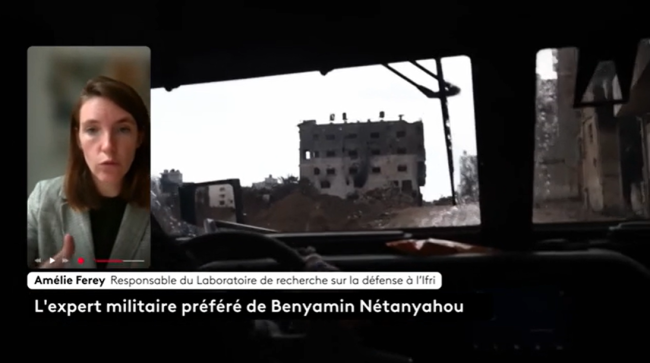Gouvernance et sociétés
Les États demeurent des piliers essentiels du système international, même s'ils n'en sont pas les seuls acteurs. Le sujet de la gouvernance se décline au niveau local, national et international.
Sujets liés

Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien

Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
Turquie 2050 : Enrichissement individuel en Turquie ; Mavi Vatan 2025 ; forêt de Belgrade
Repères sur la Turquie n°26 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Entre nationalistes conservateurs et tech-libertariens : les idées d’extrême droite dans l’administration Trump 2
Les responsables et les conseillers de l’administration Trump 2 représentent des courants idéologiques divers et, pour certains, relativement nouveaux à Washington.
Francophonie et Commonwealth : virage vers l’Asie-Pacifique au détriment de l’Afrique
Lors de leurs sommets respectifs tenus à l’automne 2024, la Francophonie et le Commonwealth, deux institutions multilatérales souvent mises en parallèle et accueillant parfois les mêmes pays, ont choisi une inflexion commune vers l’Asie-Pacifique, au détriment de l’Afrique.
Une nouvelle Syrie en marche
Le Moyen-Orient n’a pas fini de nous surprendre. Après la tragédie du 7 octobre 2023 qui a conduit à la guerre à Gaza et son extension au Liban, la prise de Damas et la chute du régime de Bachar el-Assad représentent un nouvel événement majeur dans un Moyen-Orient chaotique.
Les commandants russes de la guerre en Ukraine : purges, remaniements et mécontentements
Les remaniements du haut commandement militaire russe au cours de la guerre en Ukraine ont eu lieu de manière inégale, aussi bien dans le temps que dans les structures des forces armées. Les motifs et le calendrier des décisions prises par Vladimir Poutine concernant les cadres de l’armée défient souvent toute logique.
Justice pénale internationale : l'épreuve de vérité
La justice pénale internationale peut-elle être un facteur de paix ?
Diplomatie des villes et mobilité humaine en Afrique. La protection des réfugiés et des migrants le long de la route de la Méditerranée centrale venant de l'Afrique de l'est et de la Corne de l'Afrique
Les villes sont limitées dans leur travail sur les questions de migration et de réfugiés, souvent par manque de décentralisation et de ressources. L'adoption d'une approche en termes de "ville inclusive" peut permettre aux villes de s'engager dans la protection des résidents quel que soit leur statut, sans pour autant outrepasser les mandats légaux.
Des espaces en crise aux zones de pouvoir. Les villes africaines font de la diplomatie autour de la mobilité climatique
Les collectivités locales africaines ne peuvent rester inactives face à la mobilité climatique. Elles peuvent mettre en place des mesures pro-actives en s'appuyant sur des connaissances locales, des pouvoirs de mobilisations et un accès aux communautés concernées.
Le dilemme de la relation militaire franco-africaine : réinventer ou tourner la page ?
L’origine de la présence et de la coopération militaires en Afrique remonte au pacte tacite de la décolonisation de l’Afrique francophone. Cette coopération a permis la création des armées africaines des anciennes colonies et s’inscrivait dans le projet visant à éviter l’expansion du communisme et à maintenir l’influence de la France dans les pays nouvellement indépendants.
L'évolution de la diplomatie des villes en Afrique : impact, potentiel et défis actuels des activités internationales des villes africaines
Au cours des dernières décennies, les villes africaines se sont hissées au rang des principaux acteurs de l’évolution de la diplomatie des villes. En effet, les municipalités du continent ne se sont pas seulement adaptées aux nouvelles tendances de la coopération internationale. Elles ont façonné l’approche actuelle du partenariat où les autorités locales du monde entier travaillent ensemble pour relever des défis urbains communs tels que le changement climatique, la migration et la justice sociale.
Turquie 2050 : Enrichissement individuel en Turquie ; Mavi Vatan 2025 ; forêt de Belgrade
Repères sur la Turquie n°26 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Entre nationalistes conservateurs et tech-libertariens : les idées d’extrême droite dans l’administration Trump 2
Les responsables et les conseillers de l’administration Trump 2 représentent des courants idéologiques divers et, pour certains, relativement nouveaux à Washington.
Francophonie et Commonwealth : virage vers l’Asie-Pacifique au détriment de l’Afrique
Lors de leurs sommets respectifs tenus à l’automne 2024, la Francophonie et le Commonwealth, deux institutions multilatérales souvent mises en parallèle et accueillant parfois les mêmes pays, ont choisi une inflexion commune vers l’Asie-Pacifique, au détriment de l’Afrique.
Une nouvelle Syrie en marche
Le Moyen-Orient n’a pas fini de nous surprendre. Après la tragédie du 7 octobre 2023 qui a conduit à la guerre à Gaza et son extension au Liban, la prise de Damas et la chute du régime de Bachar el-Assad représentent un nouvel événement majeur dans un Moyen-Orient chaotique.
Les commandants russes de la guerre en Ukraine : purges, remaniements et mécontentements
Les remaniements du haut commandement militaire russe au cours de la guerre en Ukraine ont eu lieu de manière inégale, aussi bien dans le temps que dans les structures des forces armées. Les motifs et le calendrier des décisions prises par Vladimir Poutine concernant les cadres de l’armée défient souvent toute logique.
Justice pénale internationale : l'épreuve de vérité
La justice pénale internationale peut-elle être un facteur de paix ?
Diplomatie des villes et mobilité humaine en Afrique. La protection des réfugiés et des migrants le long de la route de la Méditerranée centrale venant de l'Afrique de l'est et de la Corne de l'Afrique
Les villes sont limitées dans leur travail sur les questions de migration et de réfugiés, souvent par manque de décentralisation et de ressources. L'adoption d'une approche en termes de "ville inclusive" peut permettre aux villes de s'engager dans la protection des résidents quel que soit leur statut, sans pour autant outrepasser les mandats légaux.
Des espaces en crise aux zones de pouvoir. Les villes africaines font de la diplomatie autour de la mobilité climatique
Les collectivités locales africaines ne peuvent rester inactives face à la mobilité climatique. Elles peuvent mettre en place des mesures pro-actives en s'appuyant sur des connaissances locales, des pouvoirs de mobilisations et un accès aux communautés concernées.
Le dilemme de la relation militaire franco-africaine : réinventer ou tourner la page ?
L’origine de la présence et de la coopération militaires en Afrique remonte au pacte tacite de la décolonisation de l’Afrique francophone. Cette coopération a permis la création des armées africaines des anciennes colonies et s’inscrivait dans le projet visant à éviter l’expansion du communisme et à maintenir l’influence de la France dans les pays nouvellement indépendants.
L'évolution de la diplomatie des villes en Afrique : impact, potentiel et défis actuels des activités internationales des villes africaines
Au cours des dernières décennies, les villes africaines se sont hissées au rang des principaux acteurs de l’évolution de la diplomatie des villes. En effet, les municipalités du continent ne se sont pas seulement adaptées aux nouvelles tendances de la coopération internationale. Elles ont façonné l’approche actuelle du partenariat où les autorités locales du monde entier travaillent ensemble pour relever des défis urbains communs tels que le changement climatique, la migration et la justice sociale.
L'Ukraine, attaquée jusque dans ses infrastructures énergétiques par la Russie, met le pétrole russe sous pression
Kiev et neuf régions d'Ukraine sont touchées par des coupures d'électricité après des frappes russes via des drones et des missiles mortels. Les forces ukrainiennes répliquent par des attaques de longue portée contre les infrastructures pétrolières russes, un secteur-clé pour le Kremlin. Entretien avec Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri.

Donald Trump va-t-il recevoir le prix Nobel de la paix cette année ?
Le président américain s'est félicité d'avoir « sauvé des millions de vies » en mettant fin jusqu'à « huit guerres ».
Donald Trump aura-t-il son prix Nobel de la paix ?
Vendredi sera annoncé le nom du lauréat du Prix Nobel de la Paix. Un candidat s'est fait connaître à de multiples reprises : c'est Donald Trump. Il jugeait d'ailleurs il y a une semaine que ce serait "une grande insulte contre les États-Unis" s'il n'obtenait pas le Prix Nobel. Le mérite-t-il ?
Guerre entre Israël et le Hamas : qui est John Spencer, la référence de Benyamin Netanyahou ?
Guerre entre Israël et le Hamas : qui est John Spencer, la référence de Benyamin Netanyahou ?

Israël : l'évolution sans précédent de l'opinion publique américaine
Aux États-Unis, le soutien inconditionnel à l'État hébreu s'effrite, jusque dans les rangs républicains.
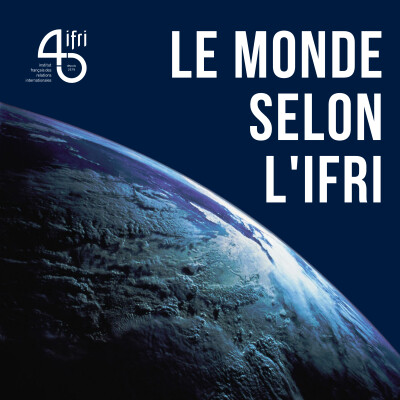
La Moldavie au lendemain des élections : entre tentation européenne et ingérences russes
Dans ce nouvel épisode du Monde selon l’Ifri, Marc Hecker reçoit Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po et chercheur associé à HEC. L'entretien, enregistré au lendemain du scrutin du 28 septembre 2025, décrypte les enjeux et les résultats des élections législatives en Moldavie.
L’Iran face aux sanctions internationales : « Une autarcie totale apparaît insoutenable »
« La Chine, principal débouché du pétrole brut iranien via les raffineries indépendantes du Shandong, est le premier pays exposé par le retour des sanctions internationales », selon l’iranologue Clément Therme. Les faits - Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et à l’Institut international d’études iraniennes (Rasanah), Clément Therme vient de publier Téhéran-Washington (1979-2025) chez Hémisphères et Idées reçues sur l’Iran. Un pouvoir à bout de souffle ? aux éditions Le Cavalier Bleu. Pour L’Opinion, il revient sur l’impact du retour des sanctions internationales contre la République islamique.
La démocratie est-elle toujours en Amérique ?
Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a pris plusieurs mesures : droits de douane imposés à de nombreux pays, création du doge, alliance avec les big tech, limogeage de personnalités, politique anti-immigration renforcée. Est-ce la fin de la démocratie aux Etats-Unis ?
Comprendre les biais de perception de l’Iran par les États-Unis depuis 1979
Voilà plus de 45 ans que les États-Unis et l’Iran sont engagés dans un conflit acharné. En 1979, le régime du Shah, allié de Washington depuis la Seconde Guerre mondiale, est renversé par la Révolution islamique qui aboutit à l’instauration d’un régime théocratique dirigé par un Guide suprême – l’ayatollah Rouhollah Khomeyni jusqu’à son décès en 1989, l’ayatollah Ali Khamenei depuis lors.
RDC / Rwanda : l’échec des accords de paix ?
En République démocratique du Congo, la crise humanitaire demeure aiguë et les combats ont repris dans l’Est du territoire, alors même qu’au mois de juillet, Kigali et Kinshasa avaient signé le premier volet des accords de paix. Tout espoir est-il aujourd’hui vain ?

Corée du Sud : victoire du candidat de centre-gauche
Lee Jae-myung, chef du Parti démocrate qui dispose déjà d'une confortable majorité au Parlement, était le grand favori de cette présidentielle à un tour.

Macron en Asie, un pari sur l'avenir ?
Vietnam, Indonésie, Singapour : Emmanuel Macron entame une semaine de visite d’État en Asie du Sud-Est : le président français veut incarner la troisième voix dans une région en proie aux ambitions américaines et chinoises.
Le duel Trump - Chine : le front indo-pacifique
Dans le duel entre la Chine et les Etats-Unis, l’imprévisibilité de Donald Trump offre-t-elle des opportunités inattendues à Xi Jinping ? Quels enjeux autour de l’Asie du Sud-Est, cet autre front qui concentre une bonne part de la population et de l’économie mondiales ?

Allemagne : Les hommes du chancelier
Ouvrez le Who's who fédéral ! Qui fait quoi et qui est qui dans l'équipe de Merz ? Un épisode qui dresse le portrait de six ministres (et un secrétaire d'état) : des noms à retenir, des visages à identifier ! A écouter par chapitres... en cherchant les femmes ! Avec Anna Clauss du Der Spiegel sur Alexander Dobrindt ; Jean-Marie Magro du BR sur Doro Bär et Alois Rainer ; Paul Maurice du Cerfa (Ifri) sur Johann Wadephul et Gunther Krichbaum ; Stefan Seidendorf du DFI sur Lars Klingbeil. Reportage à la conférence annuelle du Forum pour l'Avenir franco-allemand, sur Katharina Reiche.

Moyen-Orient : ce qui change | Une leçon de géopolitique
Depuis l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire isréalien, le Moyen-Orient n’en finit plus de connaître des crises à répétition.

Chine : les craintes d'invasion de Taïwan sont-elles justifiées ?
"Tonnerre dans le détroit" : c’était début avril et c’était le nom d’un exercice militaire chinois autour de Taïwan.

Afrique : quelle démocratie ?
Des auditeurs voient dans la démocratie une volonté de mainmise occidentale et reprochent à RFI d'en être le relais. Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri, apporte son analyse.

Élection du pape Léon XIV : qui sont les catholiques américains ?
Aux États-Unis, les catholiques, nombreux mais divisés, restent une force influente dans la société.
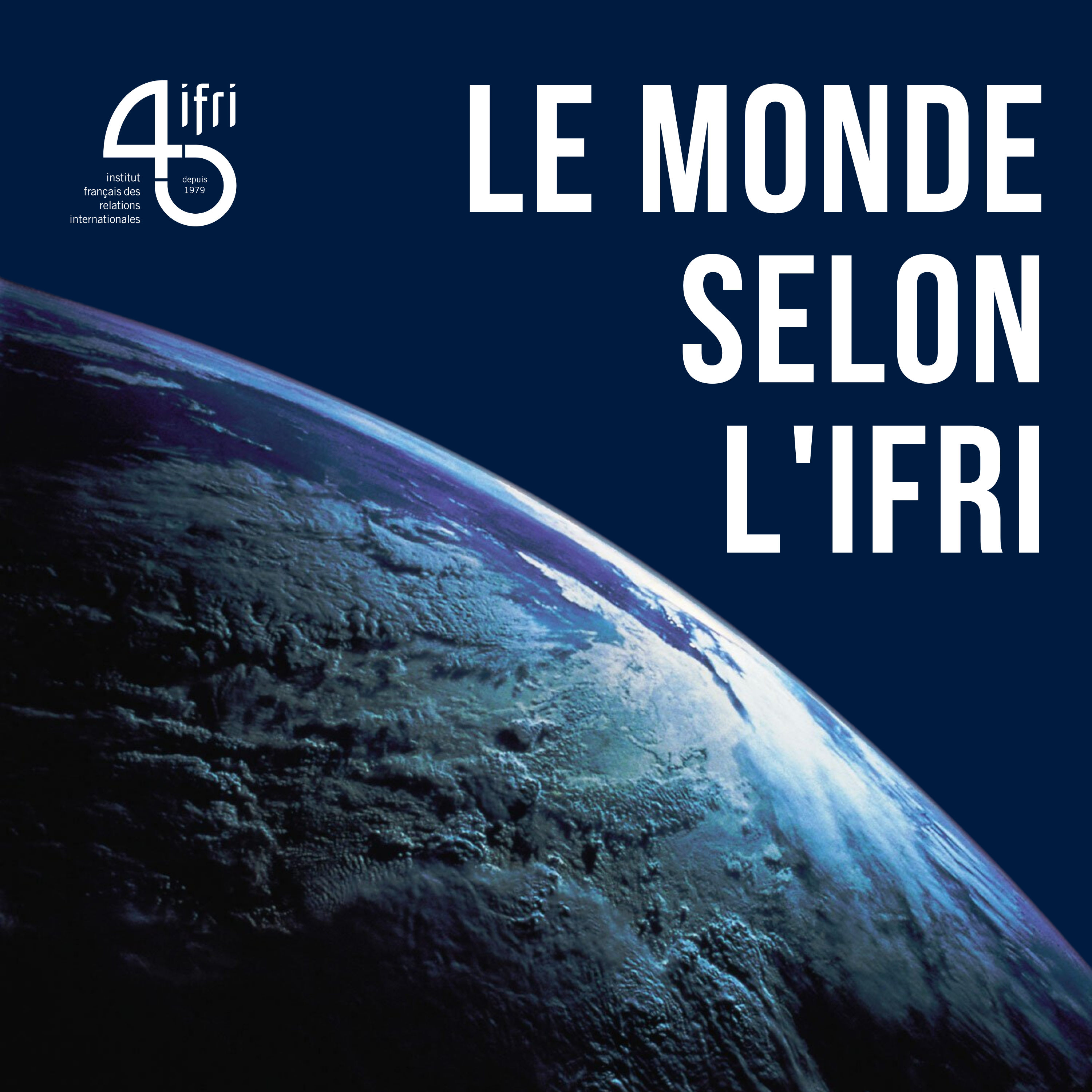
Techno-solutionnisme : la Silicon Valley à l’assaut de la Maison-Blanche ?
Faut-il tout attendre de la technologie ? Peut-elle résoudre les grands défis de notre époque, des pandémies à la transition énergétique, en passant par la gouvernance des sociétés ? Dans ce nouvel épisode du podcast Le monde selon l’Ifri, nous interrogeons les fondements idéologiques et politiques du solutionnisme technologique.
France-Allemagne : une nouvelle romance ?
Les attentes sur un renouveau des relations franco-allemandes sont grandes après l'élection de Merz. Fidèle à la tradition, le nouveau chancelier d'Allemagne effectue son premier voyage à l'étranger à Paris. Macron et Merz souhaitent notamment mieux se concerter sur l'accord de libre-échange Mercosur et le marché européen de l'électricité.

Antivax, complotiste et anti-industries agroalimentaires : comment comprendre Robert F. Kennedy Jr. ?
Figure controversée, le neveu de JFK mêle héritage politique, engagements écologistes et positions antisystèmes.

Friedrich Merz, le chancelier qui aime la France
Le député Friedrich Merz est devenu le nouveau chancelier allemand. Bien qu’il soit désormais élu, il s’est pourtant vu infliger une déconvenue puisque, pour la première fois, les députés ne l'ont pas nommé au premier tour, mais seulement au second. Dix-huit députés de sa propre coalition lui ont notamment refusé leur vote.

Quel gouvernement en Allemagne ?
Ce mardi 6 mai, Paul Maurice, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes à l'Ifri, était l'invité d'Annalisa Cappellini dans "Le monde qui bouge - L'Interview", de l'émission Good Morning Business, présentée par Laure Closier. Ils ont parlé du gouvernement Merz qui doit être officiellement être élu chancelier par les députés du Bundestag, et de la récession de l'Allemagne depuis déjà deux ans.
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.