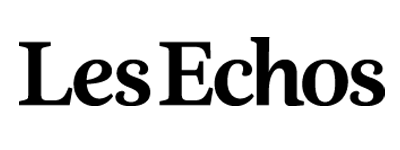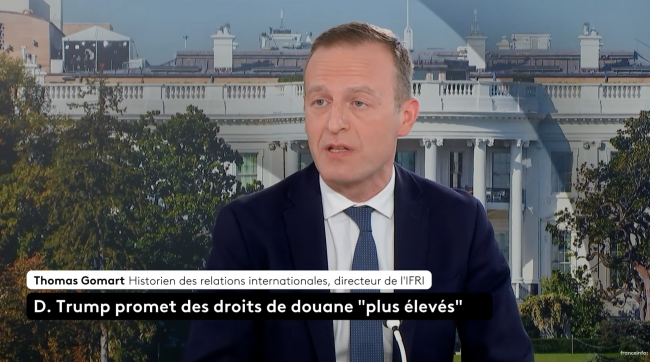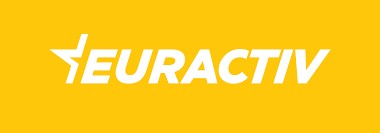Gouvernance et sociétés
Les États demeurent des piliers essentiels du système international, même s'ils n'en sont pas les seuls acteurs. Le sujet de la gouvernance se décline au niveau local, national et international.
Sujets liés

Union européenne-Inde : rapprochement durable ou partenariat de circonstance ?
Le partenariat entre l’UE et l’Inde s’est longtemps limité aux échanges économiques. Sa dimension politique s’est progressivement développée, jusqu’à être élevée au rang de « partenariat stratégique » en 2004. Néanmoins, l’échec des négociations d’un accord de libre-échange en 2013 a freiné cette dynamique. Depuis le début des années 2020, dans un contexte géopolitique incertain, le rapprochement bilatéral connaît une nouvelle accélération.
La Bundeswehr : du changement d’époque (Zeitenwende) à la rupture historique (Epochenbruch)
La Zeitenwende (« changement d’époque ») annoncée par Olaf Scholz le 27 février 2022 passe à la vitesse supérieure. Soutenues financièrement par la réforme constitutionnelle du « frein à la dette » de mars 2025 et cautionnées par un large consensus politique et sociétal en faveur du renforcement et de la modernisation de la Bundeswehr, les capacités militaires de l’Allemagne devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Appelée à jouer un rôle central dans la défense du continent européen sur fond de relations transatlantiques en plein bouleversement, la position allemande en matière politique et militaire traverse une profonde mutation.
Un « faux départ » : l’avenir des chefferies coutumières en Afrique
Au-delà du seul cas du Burkina Faso, la cérémonie hebdomadaire du « faux départ » du Moro Naba, « l’empereur des Mossi » symbolise dans l'Afrique d’aujourd'hui la position paradoxale de dirigeants traditionnels jouissant d'une influence qui se situe en marge de la sphère politique moderne tout en conservant à la différence de celle-ci, une forte dimension religieuse.
La Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Union européenne-Inde : rapprochement durable ou partenariat de circonstance ?
Le partenariat entre l’UE et l’Inde s’est longtemps limité aux échanges économiques. Sa dimension politique s’est progressivement développée, jusqu’à être élevée au rang de « partenariat stratégique » en 2004. Néanmoins, l’échec des négociations d’un accord de libre-échange en 2013 a freiné cette dynamique. Depuis le début des années 2020, dans un contexte géopolitique incertain, le rapprochement bilatéral connaît une nouvelle accélération.
La Bundeswehr : du changement d’époque (Zeitenwende) à la rupture historique (Epochenbruch)
La Zeitenwende (« changement d’époque ») annoncée par Olaf Scholz le 27 février 2022 passe à la vitesse supérieure. Soutenues financièrement par la réforme constitutionnelle du « frein à la dette » de mars 2025 et cautionnées par un large consensus politique et sociétal en faveur du renforcement et de la modernisation de la Bundeswehr, les capacités militaires de l’Allemagne devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Appelée à jouer un rôle central dans la défense du continent européen sur fond de relations transatlantiques en plein bouleversement, la position allemande en matière politique et militaire traverse une profonde mutation.
Un « faux départ » : l’avenir des chefferies coutumières en Afrique
Au-delà du seul cas du Burkina Faso, la cérémonie hebdomadaire du « faux départ » du Moro Naba, « l’empereur des Mossi » symbolise dans l'Afrique d’aujourd'hui la position paradoxale de dirigeants traditionnels jouissant d'une influence qui se situe en marge de la sphère politique moderne tout en conservant à la différence de celle-ci, une forte dimension religieuse.
La Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Ukraine : « La guerre pourrait encore durer des années et, paradoxalement, le temps joue contre le Kremlin »
Le chercheur Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie de l'Ifri et responsable scientifique de l’Observatoire Russie, Europe orientale, Caucase et Asie centrale, estime dans un entretien au « Monde » qu’« il ne faut pas enterrer l’Ukraine trop vite », même si le rapport de force est actuellement favorable à la Russie.


« Les alliés européens ne doivent pas laisser la société ukrainienne être terrorisée, frigorifiée, plongée dans le noir »
Alors que la Russie est affaiblie et risque de caler, un collectif d’intellectuels appelle, dans une tribune au « Monde », les dirigeants européens à mobiliser les systèmes de défense antiaérienne et l’aviation des armées européennes pour protéger le ciel de l’Ukraine.
Guerre en Ukraine, 4 ans après : une paix qui n’arrive pas
Alors que les négociations s'enlisent à Genève sous médiation américaine, que les morts s'accumulent des deux côtés, la Russie n'a pas bougé d'un pouce sur ses positions. Quelle paix les Ukrainiens attendent-ils, quatre ans après le début de la guerre ?
Guerre en Ukraine : « Les Russes veulent nous faire croire qu'ils ont le temps, mais ce n'est plus le cas »
Ukraine, quatre ans de guerre. Les négociations font du surplace. Les Russes font croire qu'ils ont le temps pour eux et compliquent tout avec de nouvelles exigences. Les Ukrainiens ne peuvent renoncer à une cause existentielle et les Américains, lassés, aimeraient passer à autre chose.
Vladimir Poutine : les secrets de sa stratégie
Le président russe est présenté comme l’héritier d’une école soviétique alliant pression psychologique, connaissance fine des dossiers et rejet des compromis. Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, était invitée par Le Monde pour en discuter.
"Qui contrôle qui ?" : quand la puissance domine le monde
Après la décision de la Cour suprême sur les droits de douane de Donald Trump, quelles conséquences pour l’économie mondiale ? Assiste-t-on à un affaiblissement durable du président américain ou à une recomposition plus large des équilibres internationaux ? Entre rivalité sino-américaine, tensions transatlantiques et transformation de la mondialisation, où va le capitalisme mondial ?
Boycott touristique, tensions en haute mer… Cinq minutes pour comprendre la crise diplomatique entre la Chine et le Japon
Depuis l’arrivée au pouvoir à Tokyo de Sanae Takaichi, les relations entre les deux géants se détériorent avec en fond la question de Taïwan.
Sergueï Karaganov, cet intellectuel russe qui veut bombarder l’Europe
Spécialiste des relations internationales le plus en vue de Russie, Sergueï Karaganov s’est fait, à 73 ans, le champion d’un nationalisme radical et menaçant en appelant à des frappes nucléaires sur l’Europe. Un épouvantail que valorise délibérément le Kremlin pour dissuader les Européens d’aider l’Ukraine. Dimitri Minic, chercheur spécialiste de la pensée et de la culture stratégiques russes au Centre Russie/Eurasie de l'Ifri et responsable scientifique de l’Observatoire Russie, Europe orientale, Caucase et Asie centrale, s'est entretenu avec Pierre Sautreuil.
En Syrie, des promesses en chantier
Depuis la chute du régime Assad il y a un an, la levée des sanctions occidentales a ouvert le marché syrien et suscité de nombreuses promesses de reconstruction. Ces dernières peinent toutefois à se concrétiser, les bailleurs restant frileux face à l'instabilité sécuritaire et économique du pays.
Poutine et Zelensky, Vatican et Silicon Valley... Les six duels qui vont décider de notre avenir, selon Thomas Gomart
Invité du podcast de L'Express "Les temps sauvages", le directeur de l'Institut français des relations internationales analyse les nouveaux rapports de force mondiaux.
Guerre en Ukraine, 4 ans après : une paix qui n’arrive pas
Alors que les négociations s'enlisent à Genève sous médiation américaine, que les morts s'accumulent des deux côtés, la Russie n'a pas bougé d'un pouce sur ses positions. Quelle paix les Ukrainiens attendent-ils, quatre ans après le début de la guerre ?
Vladimir Poutine : les secrets de sa stratégie
Le président russe est présenté comme l’héritier d’une école soviétique alliant pression psychologique, connaissance fine des dossiers et rejet des compromis. Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, était invitée par Le Monde pour en discuter.
"Qui contrôle qui ?" : quand la puissance domine le monde
Après la décision de la Cour suprême sur les droits de douane de Donald Trump, quelles conséquences pour l’économie mondiale ? Assiste-t-on à un affaiblissement durable du président américain ou à une recomposition plus large des équilibres internationaux ? Entre rivalité sino-américaine, tensions transatlantiques et transformation de la mondialisation, où va le capitalisme mondial ?


Inde / France : un nouveau cap ?
Emmanuel Macron est en visite officielle en Inde pendant quatre jours. Objectif : le franchissement d’une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays avec notamment l’achat confirmé la semaine dernière par l’armée de l’air indienne de 114 Rafale.
Replay - Conférence avec Chris Wright, Secrétaire à l'Énergie des États-Unis
Reçu à l'Institut français des relations internationales, Chris Wright a exposé sa vision d'une politique énergétique américaine structurée autour de deux axes : la réalité humaine de l'accès à l'énergie, et une approche fondée sur les données chiffrées. Pour le Secrétaire, l'énergie constitue le fondement de la prospérité, de la santé et de l'allongement de l'espérance de vie à l'échelle mondiale. Sa doctrine repose sur une ambition de "dominance énergétique" américaine — non pas seulement l'indépendance, mais la capacité à produire massivement afin de réduire les coûts intérieurs, réindustrialiser le pays et soutenir les alliés des États-Unis.
En Syrie, des promesses en chantier
Depuis la chute du régime Assad il y a un an, la levée des sanctions occidentales a ouvert le marché syrien et suscité de nombreuses promesses de reconstruction. Ces dernières peinent toutefois à se concrétiser, les bailleurs restant frileux face à l'instabilité sécuritaire et économique du pays.
Poutine et Zelensky, Vatican et Silicon Valley... Les six duels qui vont décider de notre avenir, selon Thomas Gomart
Invité du podcast de L'Express "Les temps sauvages", le directeur de l'Institut français des relations internationales analyse les nouveaux rapports de force mondiaux.
Près de quatre ans après l’invasion de l’Ukraine, la Russie dans tous ses états
Alors que le Kremlin annonce l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations les 17 et 18 février à Genève, quelles sont les capacités réelles de l’armée russe à poursuivre la guerre ? Comment se porte l'économie russe sous sanctions ? Et quelles alliances sur la scène internationale ? Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, analyse la situation actuelle.

Qui contrôle qui ?
Depuis un an qu’il est à la Maison Blanche, Donald Trump occupe la scène médiatique mondiale quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Un effet de saturation qui, peut-être, nous fait rater des transformations très profondes ailleurs.
Retour sur la Conférence navale de Paris 2026 : réarmement naval et opérations en environnement contesté
Du 2 au 3 février 2026, s'est tenue la 4e édition de la Conférence navale de Paris, à l'Ifri et au Musée national de la Marine. Cette conférence exceptionnelle, organisée par l'Ifri et la Marine nationale portait cette année sur le réarmement naval et le défi des opérations en eaux contestées.
Psychologie et désir dans les relations internationales
Dans cet entretien, Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, présente les thèses de son ouvrage Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux paru aux éditions Tallandier.
La dimension environnementale de l'accord Union européenne - Inde
Le 27 janvier 2026, l'Europe et l'Inde signaient un traité commercial en gestation depuis près de vingt ans. S'il satisfait les objectifs stratégiques des deux puissances, l'accord élude néanmoins les tensions soulevées par l'illibéralisme croissant du régime Modi ou par la proximité indo-russe.

L'« accord de tous les accords » entre Inde et UE ? Enjeux géopolitiques et économiques
Marie Krpata, analyse les enjeux de l’accord commercial entre l’Union européenne et l’Inde qui a été scellé le 27 janvier 2026 à New Delhi en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil, António Costa. « C'est l'accord de tous les accords », s'est réjoui le Premier ministre indien Narendra Modi.
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.